La scène de ces étudiants contraints de préparer eux-mêmes leurs repas sur les campus, à la suite de la fermeture des restaurants universitaires, s’impose comme une image troublante. Elle ne choque pas par la débrouille qu’elle met en lumière, mais par ce qu’elle révèle en creux : l’incapacité momentanée d’un système universitaire à garantir les conditions minimales de la vie étudiante. À Dakar, cette situation ne saurait être réduite à un incident conjoncturel ni à une agitation circonstancielle. Elle constitue l’expression visible d’un déséquilibre structurel, longtemps contenu, désormais exposé au grand jour.
L’université, et singulièrement l’Université Cheikh-Anta Diop, n’est pas un espace abstrait de production de savoir. Elle est un lieu de vie dense, traversé quotidiennement par des dizaines de milliers d’étudiants dont l’équilibre repose sur des dispositifs publics précis : la bourse, la restauration subventionnée, le logement, les transports. Dans un tel environnement, la défaillance d’un seul de ces mécanismes suffit à rompre des équilibres déjà fragiles. La tension qui en résulte n’est ni progressive ni diffuse : elle se manifeste immédiatement, car les marges individuelles sont faibles, parfois inexistantes.
Les données chiffrées sont connues et méritent d’être rappelées avec rigueur. Les universités publiques sénégalaises accueillent près de deux cent mille étudiants, dont environ les trois quarts bénéficient d’une bourse. L’État consacre chaque année entre quatre-vingts et quatre-vingt-dix milliards de francs CFA à ces allocations, auxquels s’ajoutent des montants substantiels dédiés à la restauration universitaire. Ces chiffres attestent d’un engagement financier réel. La crise actuelle ne saurait donc être imputée à un désengagement budgétaire, mais bien à une difficulté d’organisation et de temporalité dans l’exécution de cette dépense publique.
Pour une large majorité d’étudiants, la bourse universitaire ne constitue pas un simple appui. Elle est la ressource centrale, parfois exclusive, sur laquelle repose l’ensemble de leur vie quotidienne. Lorsqu’elle tarde, il n’existe ni amortisseur ni période de transition. Les effets sont immédiats : retards de loyers, renoncements alimentaires, endettement informel. Ce qui peut apparaître, du point de vue administratif, comme un décalage technique devient, sur le terrain, une rupture tangible des conditions de vie.
Toutefois, le diagnostic serait incomplet s’il se limitait à la question du paiement courant. Le nœud du problème se situe en amont, au démarrage même de l’année universitaire. Durant les trois ou quatre premiers mois, le temps que les listes définitives d’allocataires soient arrêtées, les versements sont différés. Ces mois ne sont ni annulés ni effacés : ils s’accumulent. Il en résulte la constitution progressive d’un stock d’arriérés communément appelés rappels qui, une fois les paiements enclenchés, représente une masse financière considérable. Ce mécanisme transforme un délai administratif en contrainte budgétaire différée, dont les effets sociaux se manifestent bien avant que les fonds ne soient effectivement décaissés.
Il convient ici de lever toute ambiguïté. Une fois le circuit relancé, les paiements courants sont, dans l’ensemble, assurés. La persistance de la tension ne tient donc pas à une défaillance continue du versement, mais au poids durable des rappels accumulés, qui continuent d’affecter la situation des étudiants longtemps après la reprise des paiements.
La fermeture des restaurants universitaires est venue amplifier cette fragilité. Elle a mis en lumière une contradiction difficilement soutenable : maintenir des services subventionnés lorsque les bénéficiaires n’ont plus de liquidités revient à exposer ces services à une fragilisation accrue. Certains étudiants en sont venus à consommer sans payer, non par esprit de défi, mais par nécessité. Ce comportement, compréhensible du point de vue social, n’en demeure pas moins destructeur pour les œuvres universitaires, lesquelles reposent sur des équilibres financiers précis et ne disposent pas des marges nécessaires pour absorber une gratuité non compensée.
À cette contrainte matérielle s’ajoute un facteur plus diffus, mais tout aussi déterminant : l’incertitude. Les étudiants peuvent accepter une situation difficile, à condition qu’elle soit expliquée et balisée. Ce qu’ils supportent mal, en revanche, ce sont les annonces imprécises, les calendriers mouvants et les ajustements tardifs, qui nourrissent un sentiment d’abandon plus profond que la pénurie elle-même.
La question du logement universitaire vient encore complexifier le tableau. À Dakar comme dans les universités régionales, l’offre demeure très inférieure à la demande. Une minorité d’étudiants bénéficie d’un hébergement sur le campus ; la majorité dépend du marché privé, souvent coûteux et précaire. Lorsque la bourse tarde, ce n’est plus seulement l’alimentation qui est menacée, mais la stabilité résidentielle elle-même. Ces situations, rarement visibles, contribuent pourtant de manière décisive à la détérioration du climat social universitaire.
Cette crise doit enfin être replacée dans une dynamique plus large : celle de la massification de l’enseignement supérieur sans adaptation suffisante des dispositifs sociaux qui l’accompagnent. Chaque année, les effectifs augmentent, sans que les capacités d’accueil, de restauration et de soutien financier ne suivent au même rythme. Ce décalage structurel rend le système particulièrement vulnérable aux chocs budgétaires.
Il existe également une dimension rarement explicitée : celle de l’équité intergénérationnelle. Les déséquilibres actuels sont largement hérités, mais leurs effets sont supportés par une génération qui n’en est pas responsable. Lorsque l’ajustement s’opère par accumulation d’arriérés, par attente prolongée ou par silence, une injustice silencieuse s’installe, dont les effets ne s’effacent pas avec un paiement tardif.
Pourtant, dans d’autres secteurs confrontés aux mêmes contraintes budgétaires, l’État a démontré qu’une autre méthode était possible. En choisissant la transparence, le dialogue et la clarté des engagements, il est parvenu à stabiliser les relations sociales. La question se pose alors avec acuité : pourquoi l’université ne bénéficierait-elle pas d’un cadre similaire, fondé sur la vérité des chiffres et la prévisibilité des décisions ?
Gouverner en période de contrainte impose des choix lisibles et assumés. Dire ce qui peut être payé immédiatement, ce qui doit être étalé, et dans quels délais. Annoncer moins, mais tenir davantage. Les réponses ne relèvent ni de l’incantation ni de la confrontation, mais de l’organisation : sécuriser un socle minimal de versement, traiter les arriérés comme un problème distinct, protéger les œuvres universitaires et instaurer un dialogue structuré avec les représentants étudiants.
Ce qui se joue aujourd’hui à l’université dépasse la seule question étudiante. Cela interroge, plus largement, la capacité de l’action publique à préserver sa crédibilité lorsque les ressources se raréfient.
La crise universitaire n’est pas un échec social. Elle constitue une épreuve de gouvernance, révélatrice de la manière dont un État choisit d’agir lorsque la contrainte devient la règle.
Hady TRAORE
Expert-conseil
Gestion stratégique et Politique Publique-Canada
Fondateur du Think Tank : Ruptures et Perspectives
hadytraore@hotmail.com














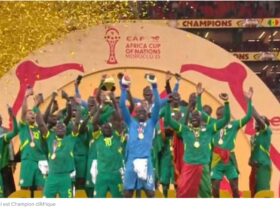
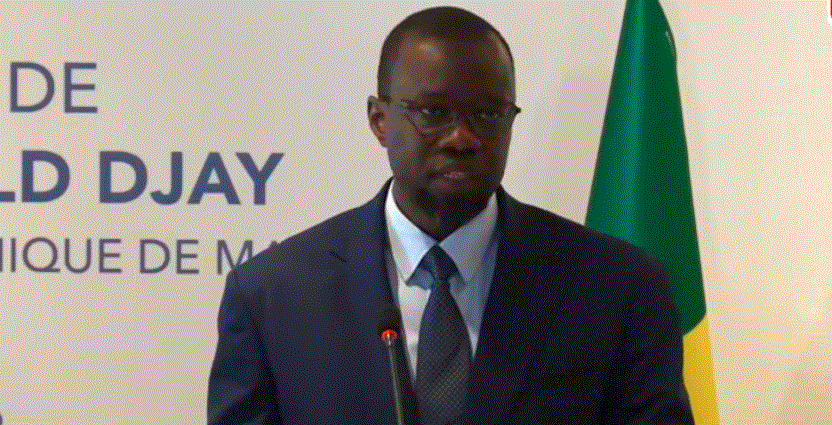


Laisser une Réponse