Cette semaine, Dakar a posé un acte stratégique clair. En accueillant une délégation émiratie conduite par le ministre du Commerce extérieur et en signant plusieurs mémorandums sectoriels, le Sénégal a opté pour le co-investissement comme levier de financement et de transformation. Un choix assumé, dans un contexte de contraintes financières persistantes, qui marque une inflexion méthodologique : élargir les marges d’action de l’État par le partage du risque et la diversification des partenaires.
Mon coup de cœur de la semaine tient précisément dans cette séquence. Non parce qu’elle additionne des accords ou aligne des secteurs, mais parce qu’elle révèle une capacité devenue rare : celle d’un État qui, confronté à la contrainte, choisit la méthode plutôt que l’attente. La visite de la délégation émiratie à Dakar et la signature des mémorandums ne relèvent pas d’une gesticulation diplomatique. Elles traduisent une inflexion profonde dans la manière dont le Sénégal entend financer sa transformation économique.
Le contexte international dans lequel intervient cette décision est déterminant. Le Sénégal ne fait pas face à une crise de solvabilité brutale, mais à un resserrement progressif de ses marges financières externes, accentué par l’allongement des cycles multilatéraux et par des incertitudes procédurales persistantes dans l’accès aux financements traditionnels. Cette situation met en lumière un décalage structurel bien documenté par la littérature d’économie politique du développement : celui qui oppose des institutions financières internationales conçues pour gérer la stabilité à des États engagés dans des trajectoires de rupture nécessitant rapidité, flexibilité et capacité d’arbitrage. Dani Rodrik a montré combien cette tension réduit l’espace d’innovation des gouvernements ; Joseph Stiglitz a, pour sa part, souligné les effets parfois procycliques de conditionnalités appliquées à des économies en transition.
Face à cette configuration, deux options se dessinent classiquement : l’attentisme discipliné ou la diversification stratégique. Le Sénégal a clairement opté pour la seconde. Les mémorandums signés avec les Émirats arabes unis ne constituent ni une rupture avec le multilatéralisme ni une fuite en avant. Ils s’inscrivent dans une logique de complémentarité assumée, fondée sur un principe simple : aucun État responsable ne peut dépendre durablement d’un seul canal de financement, aussi légitime soit-il. Le co-investissement devient ici un instrument de souveraineté fonctionnelle, permettant de partager le risque, d’ancrer les capitaux dans l’économie réelle et de préserver la capacité d’action publique.
Ce choix du co-investissement mérite, à ce stade, d’être explicitement distingué des montages classiques de partenariats public-privé (PPP), trop souvent confondus dans le débat public. Le PPP, dans sa forme dominante, repose sur une logique de délégation : l’État confie à un opérateur privé le financement, la construction et parfois l’exploitation d’une infrastructure, en contrepartie d’engagements contractuels de long terme, souvent adossés à des garanties publiques, des paiements différés ou des clauses de rentabilité minimale. Ce modèle, s’il a permis la réalisation de projets structurants, a également montré ses limites : rigidité contractuelle, asymétrie d’information, renégociations coûteuses et, dans certains cas, transfert différé mais réel du risque vers les finances publiques.
Le co-investissement procède d’une logique fondamentalement différente. Il ne repose pas sur la délégation, mais sur le partage du capital, du risque et de la gouvernance. L’État n’y est pas un simple garant ni un payeur en dernier ressort ; il devient partie prenante de l’investissement, co-actionnaire du projet, et conserve une capacité d’arbitrage stratégique tout au long du cycle. Les partenaires privés, de leur côté, assument une part effective du risque économique, ce qui aligne davantage les incitations et limite les comportements opportunistes. La performance réelle du projet conditionne alors la rémunération de l’ensemble des parties, sans mécanisme automatique de socialisation des pertes.
Cette différence n’est pas théorique. Elle s’est matérialisée, par le passé, dans des projets où l’État, engagé dans des montages de type PPP, s’est retrouvé lié par des contrats rigides, peu réversibles, avec une marge de manœuvre réduite face à l’évolution des coûts, des usages ou du contexte macroéconomique. À l’inverse, des expériences plus récentes fondées sur des prises de participation croisées et une gouvernance partagée ont montré qu’un État présent au capital conserve une capacité d’ajustement, de redéfinition des priorités et de protection de l’intérêt général, y compris lorsque les hypothèses initiales doivent être corrigées. Cette orientation rapproche le Sénégal des pratiques observées dans certains États émergents qui, à l’instar du Maroc dans l’énergie, du Rwanda dans les infrastructures stratégiques ou encore de plusieurs économies asiatiques appuyées sur des fonds souverains actifs, ont progressivement délaissé les PPP rigides au profit de schémas de co-investissement offrant une meilleure maîtrise des actifs, du risque et du temps long.
Cette orientation n’aurait toutefois aucune crédibilité sans un élément central : la cohérence au sommet de l’exécutif. Les accords conclus à Dakar sont l’aboutissement d’orientations concertées entre le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et son Premier ministre, Ousmane Sonko. Cette convergence stratégique, rare par sa lisibilité, constitue un signal fort pour les partenaires internationaux. Les travaux de Peter Evans sur les États capables montrent que la crédibilité externe repose moins sur l’orthodoxie affichée que sur la clarté de la chaîne de décision interne et la stabilité du cap politique. Dans cette séquence, le Sénégal parle d’une seule voix.
Les deux visites successives du Premier ministre Ousmane Sonko aux Émirats arabes unis prennent alors tout leur sens. Elles n’étaient ni exploratoires ni symboliques. Elles relèvent d’une diplomatie de négociation directe, fondée sur la présence personnelle du chef du gouvernement, la réduction de l’incertitude politique et l’engagement explicite des décideurs au plus haut niveau. La théorie des jeux à deux niveaux développée par Robert Putnam éclaire utilement cette dynamique : un négociateur international est d’autant plus crédible qu’il peut démontrer que ses engagements externes sont adossés à une cohérence politique interne solide.
À Abou Dhabi, le Sénégal n’a pas adopté une posture de demande. Il a présenté une architecture stratégique claire, articulée autour de projets identifiés, hiérarchisés et alignés sur l’Agenda national de transformation. Le leadership du Premier ministre s’est exprimé dans la négociation elle-même : clarification des attentes, refus des projets périphériques, insistance sur la production locale, la structuration de chaînes de valeur et le transfert de capacités. Max Weber parlait de rationalité en finalité ; cette rationalité irrigue l’ensemble de cette séquence.
L’architecture sectorielle des mémorandums confirme cette cohérence. L’énergie, parce qu’elle conditionne le coût systémique de l’économie et la compétitivité globale. Les ressources minières, parce que l’exportation brute enferme les pays dans le piège bien documenté de la détérioration des termes de l’échange. La santé et la production pharmaceutique, parce que la pandémie de Covid-19 a révélé la fragilité extrême des chaînes d’approvisionnement mondiales. Le numérique, enfin, parce qu’il constitue désormais l’ossature de la discipline budgétaire, de la transparence fiscale et de la performance administrative.
Reste l’épreuve décisive : l’exécution. L’histoire administrative sénégalaise, comme celle de nombreux États comparables, est jalonnée d’accords ambitieux dont l’impact réel a été dilué par la fragmentation institutionnelle, l’insuffisance des mécanismes de suivi et l’absence de redevabilité. La réussite de cette stratégie dépendra moins de la qualité juridique des mémorandums que de la rigueur du pilotage, de l’arbitrage et de l’évaluation.
Au-delà des accords eux-mêmes, ce qui se dessine est une inflexion doctrinale. Gouverner sous contrainte ne consiste pas à promettre davantage, mais à choisir mieux. La coopération entre le Sénégal et les Émirats arabes unis n’est ni une alternative de circonstance aux financements multilatéraux ni une rupture avec l’ordre international. Elle incarne une stratégie de résilience active, fondée sur l’élargissement de l’espace de négociation de l’État et la reconquête progressive de sa capacité de décision.
Si cette séquence devait faire date, ce ne serait pas pour le nombre de mémorandums signés, mais pour ce qu’elle révèle : un État qui assume le réel sans posture victimaire, qui articule cohérence politique interne et crédibilité externe, et qui conçoit la souveraineté non comme un slogan, mais comme une pratique quotidienne d’adaptation stratégique. Dans un monde incertain, cette lucidité n’est plus un luxe : elle est devenue une condition de gouvernement.
Hady TRAORE
Expert-conseil
Gestion stratégique et Politique Publique-Canada
Fondateur du Think Tank : Ruptures et Perspectives
hadytraore@hotmail.com














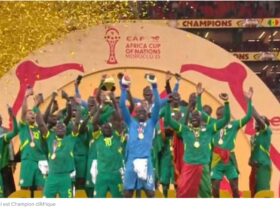
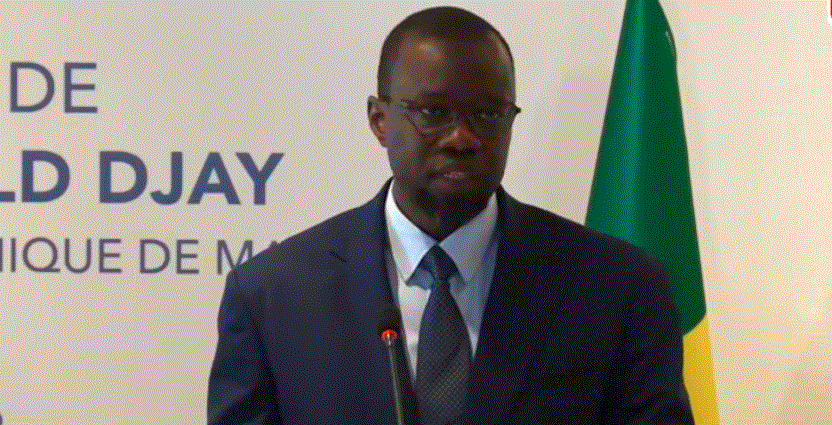


Laisser une Réponse