La dégradation de la note souveraine du Sénégal par Moody’s a électrisé l’actualité économique et politique. Mais à bien y regarder, ce n’est pas une sanction technique : c’est une réaction idéologique. En cause, non pas une insolvabilité réelle, mais une audace politique. Cette tribune démonte la mécanique biaisée de Moody’s, dénonce les opposants qui s’en réjouissent sans comprendre, et appelle à bâtir un système d’évaluation souverain, africain, ancré dans la réalité des nations. Car la vraie note d’un pays ne se lit pas dans les rapports d’agence, mais dans la cohésion de son peuple et la maturité de son pilotage.
Il faut en finir avec la peur des sigles. Moody’s n’est ni une institution morale, ni une boussole universelle. C’est une entreprise privée américaine, fondée sur un modèle d’affaires qui consiste à vendre la peur, à spéculer sur la confiance et à transformer des perceptions en vérités financières. Lorsqu’elle dégrade la note du Sénégal, ce n’est pas la solvabilité d’un pays qu’elle sanctionne, c’est une orientation politique : celle d’un État qui tente de s’émanciper des diktats extérieurs pour redéfinir son rapport à la dette, à la dépense et à la souveraineté. Derrière le langage technique des ratios et des pourcentages, il faut lire une autre histoire : celle d’un pouvoir illégitime qui prétend juger les nations au nom d’une rationalité économique dont il est, en réalité, le principal bénéficiaire.
Moody’s ne parle pas au nom de l’économie mondiale ; elle parle au nom du capital. Son jugement n’est pas un verdict, c’est une opinion commercialisée, construite à partir d’un prisme idéologique : celui du marché. Elle évalue la « confiance » que peuvent accorder les investisseurs internationaux à un État, non pas sa capacité réelle à produire, à se réformer, à garantir la stabilité ou à protéger ses citoyens. Ce n’est donc pas la solidité du Sénégal qui est questionnée, mais sa conformité à une norme de dépendance. Une norme qui privilégie le pays docile, qui signe sans discuter, qui ajuste sans contester, qui emprunte pour obéir et qui dépense pour rassurer.
Depuis la crise des subprimes en 2008, ces agences ont perdu toute légitimité morale. Moody’s, Standard & Poor’s et Fitch avaient alors attribué la note « AAA », la meilleure possible, à des produits financiers toxiques qui ont provoqué l’une des plus grandes récessions de l’histoire moderne. Elles ont noté positivement des banques qui ont ensuite fait faillite, des États qui ont dissimulé leurs dettes, des institutions qui manipulaient leurs bilans. Elles n’ont rien vu venir de la crise grecque, ni des scandales financiers d’Enron ou de Lehman Brothers. Et pourtant, elles continuent, impunément, de distribuer les bons et les mauvais points aux pays africains, comme si leur jugement conservait une once de crédibilité.
Ce qu’elles appellent « risque » n’est souvent qu’un prétexte à la discipline. Le Sénégal, selon Moody’s, serait désormais « plus risqué » parce que son ratio dette/PIB atteindrait 119 % et son ratio dette/recettes 581 %. Ces chiffres, présentés sans contexte, sont devenus des armes de communication. Or une dette n’est pas un fardeau absolu : elle est une fonction de la croissance, de la structure de financement, de la confiance interne et du temps. Le Japon a une dette supérieure à 250 % du PIB et reste noté A1. Les États-Unis, avec plus de 120 % de dette publique, conservent leur double A. Ce que l’on tolère pour les puissants devient scandaleux pour les émergents. Ce que l’on appelle « flexibilité budgétaire » en Europe devient « insoutenabilité » en Afrique. Voilà le deux poids deux mesures de la finance mondialisée.
L’évaluation de Moody’s repose sur une conception coloniale de la stabilité : pour être « crédible », un pays africain doit s’aligner sur les prescriptions du FMI, même si elles étranglent sa demande intérieure et freinent son investissement public. Dès qu’un gouvernement tente de diversifier ses sources de financement, d’élargir sa base fiscale, de produire avant de s’endetter, la notation s’assombrit. Non pas parce qu’il devient moins solvable, mais parce qu’il devient moins prévisible pour les marchés. Moody’s sanctionne donc l’audace politique, pas l’insolvabilité ; la recherche d’autonomie, pas la mauvaise gestion.
Et c’est ici qu’il faut faire preuve de lucidité. Certains responsables politiques, à court d’arguments et en quête de visibilité, se saisissent de la note de Moody’s comme d’un levier d’opposition. Ils dénoncent ce qu’ils appellent la « confusion des rôles institutionnels » sans toujours en maîtriser les ressorts techniques. Dans leur empressement, ils oublient que la notation dégradée touche l’ensemble du pays, et non un camp particulier. Cette précipitation dans la critique, parfois plus sonore que substantielle, reflète moins une vision alternative qu’un opportunisme discursif. Une démocratie exige de ses opposants qu’ils éclairent, pas qu’ils amplifient les jugements venus d’ailleurs.
Le débat économique, pour être utile, doit rester un exercice d’exigence intellectuelle. Ce n’est pas en empruntant des jugements extérieurs à des fins partisanes que l’on renforce sa crédibilité, mais en construisant une pensée propre, articulée autour d’analyses rigoureuses et de propositions solides. Le Sénégal a besoin d’oppositions constructives, capables de questionner sans dénigrer, de critiquer sans se réjouir des turbulences. Car au fond, la responsabilité patriotique consiste à souhaiter, pour son pays, la rigueur et la stabilité, quel que soit le pouvoir en place.
L’agence évoque des « négociations lentes avec le FMI ». En réalité, aucun programme formel n’a encore été soumis au Sénégal : ce sont les autorités du FMI qui tardent à arrêter une position claire. Le Sénégal, lui, reste disponible et cohérent dans sa ligne de conduite, mais attend que les partenaires internationaux sortent de l’ambiguïté.
Le vrai enjeu n’est pas la solvabilité, mais la liquidité : le Sénégal honore toutes ses échéances, continue d’attirer des capitaux, et affiche un dynamisme fiscal jamais atteint. Les marchés régionaux absorbent la demande, et les bons du Trésor sénégalais restent souscrits. Le pays n’est pas au bord du défaut, il est au cœur d’une recomposition financière : celle d’un modèle où la dette devient un outil de transformation et non un piège de dépendance. Mais dans la logique de Moody’s, tant que cette transformation échappe à l’orthodoxie occidentale, elle est suspecte.
Le plus paradoxal est que cette dégradation intervient au moment précis où le Sénégal réforme, rationalise, audite et renégocie les termes de sa dette. C’est une punition politique, pas une évaluation technique. En réalité, ce que Moody’s reproche au Sénégal, c’est de vouloir exister par lui-même : de vouloir assainir sans s’humilier, produire avant d’emprunter, et gouverner avec transparence sans s’inféoder. L’agence parle de « risques accrus » ; mais le vrai risque, pour elle, c’est qu’un pays africain démontre qu’il peut réussir hors de la tutelle des institutions financières occidentales.
Il faut relire l’histoire pour comprendre. Dans les années 1980, les mêmes logiques ont asphyxié les économies africaines à coups de programmes d’ajustement structurel. Sous prétexte de rationalité budgétaire, on a détruit les services publics, bradé les entreprises nationales, et hypothéqué la souveraineté économique du continent. Trente ans plus tard, les agences de notation reprennent le flambeau : elles ne dictent plus les politiques, mais elles en conditionnent la perception. Ce n’est plus le FMI qui impose, c’est Moody’s qui menace. Et à travers elle, ce sont les fonds d’investissement, les institutions régionales et les gouvernements complaisants qui relaient cette pression.
La dette, dans ce contexte, devient une frontière idéologique. Elle n’est plus un instrument de financement du développement, mais un levier de contrôle politique. Les pays africains n’empruntent pas pour exister, ils empruntent pour rester dans le cercle de la respectabilité financière. Moody’s leur rappelle la règle : celui qui parle de souveraineté doit accepter la sanction de la note. Celui qui critique le système sera classé « Caa1 », comme un mauvais élève. Or, il est temps de renverser cette hiérarchie : ce n’est pas le Sénégal qui est à noter, c’est Moody’s qu’il faut interroger. Quelle est sa légitimité ? Qui la contrôle ? À qui rend-elle des comptes ?
Les États-Unis, qui lui ont permis d’exister, ne la consultent pas pour définir leur politique budgétaire. L’Allemagne et la France la contestent ouvertement lorsqu’elle s’aventure sur leur terrain. Mais lorsqu’il s’agit de l’Afrique, son jugement devient dogme, ses rapports deviennent vérité, et ses prévisions deviennent prophéties. Cette asymétrie est la preuve d’un racisme institutionnel, feutré, intégré dans la mécanique financière mondiale. Car dans le fond, Moody’s ne mesure pas la rigueur des États africains : elle mesure la distance qui les sépare de la soumission.
Le Sénégal, lui, n’a pas à trembler. Son économie reste l’une des plus dynamiques du continent, sa gouvernance budgétaire s’assainit, ses recettes progressent, et ses chantiers structurants avancent. Ce que les chiffres ne disent pas, c’est la qualité du pilotage : la réduction des dépenses de prestige, la réallocation vers les secteurs productifs, la transparence sur les passifs cachés, la rationalisation du portefeuille public. Ce sont là les véritables indicateurs de solvabilité : ceux qui traduisent une volonté politique, pas un réflexe comptable.
Le moment est venu de bâtir notre propre outil d’évaluation. L’Afrique n’a pas besoin qu’on la note ; elle a besoin qu’on la comprenne. Une agence africaine de notation souveraine, rattachée à l’Union africaine ou à la CEDEAO, pourrait établir des critères adaptés : croissance endogène, stabilité institutionnelle, discipline fiscale, productivité sociale du capital investi. Une telle agence ne flatterait pas les marchés : elle informerait les citoyens, renforcerait la transparence et redonnerait du sens à la donnée économique.
Car le véritable indicateur de confiance, c’est le peuple. C’est la capacité d’une nation à mobiliser ses ressources internes, à produire, à payer ses impôts, à croire en ses institutions. La vraie note du Sénégal se lit dans la stabilité de ses prix, dans la régularité de ses salaires, dans la vitalité de ses PME, dans la discipline de sa dépense publique. C’est cela, la solvabilité d’un État : sa cohésion, son intelligence collective, sa confiance en l’avenir.
Il faut enfin dire la vérité : Moody’s ne détient aucun pouvoir autre que celui qu’on lui accorde. Si les peuples cessent de se définir par le regard des marchés, ce pouvoir s’effondre. La notation n’est qu’un miroir déformant, un instrument d’influence parmi d’autres. Elle ne crée ni valeur, ni croissance, ni confiance. Elle observe, commente, et souvent déforme. Elle ne mérite pas la crainte qu’on lui prête, encore moins le respect qu’on lui accorde.
Le Sénégal doit répondre par la fermeté, non par la panique. Expliquer, déconstruire, éclairer. Faire comprendre à ses partenaires que sa trajectoire budgétaire n’est pas une dérive, mais une réorganisation. Montrer que son déficit est un investissement, que sa dette est une transition, et que sa gouvernance financière repose désormais sur des principes d’équité, de responsabilité et de transparence. Ce n’est pas la note qui construit la confiance, c’est la cohérence.
Dans le monde multipolaire qui s’installe, la domination des agences de notation touche à sa fin. Les BRICS, l’Union africaine et les alliances régionales bâtissent leurs propres mécanismes de financement et de garantie. Demain, c’est l’Afrique qui évaluera l’Afrique. Et le Sénégal, fidèle à sa tradition d’avant-garde, peut ouvrir cette voie. En refusant de plier devant Moody’s, il affirme une vérité simple mais révolutionnaire : nous ne sommes pas pauvres, nous avons été appauvris ; nous ne sommes pas insolvables, nous avons été mal jugés ; nous ne sommes pas en crise, nous sommes en reconstruction.
La souveraineté économique commence par la souveraineté du regard. Reprendre la main sur la narration, c’est déjà sortir du piège. Moody’s pourra continuer à écrire des rapports, à abaisser des notes, à publier des alertes : le Sénégal, lui, avancera. Moody’s a rendu son verdict ; le Sénégal, lui, trace sa voie. Et dans la longue marche de l’histoire, ce ne sont jamais les agences qui décident du destin des nations, mais les peuples qui refusent de plier.
Hady TRAORE
Expert-conseil
Gestion stratégique et Politique Publique-Canada
Fondateur du Think Tank : Ruptures et Perspectives
hadytraore@hotmail.com










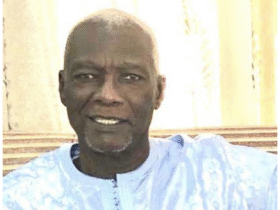



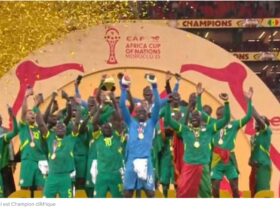
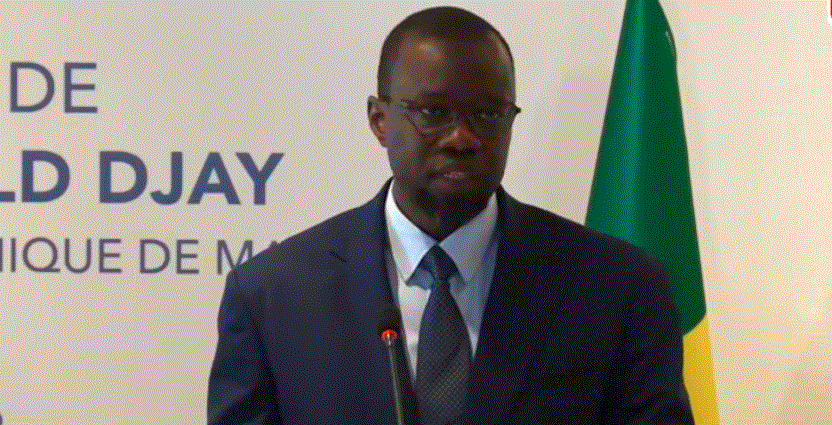


Laisser une Réponse