Tandis que le pouvoir exécutif sénégalais affiche une volonté sans équivoque de restaurer l’éthique publique, certains prennent la fuite. Ce n’est pas la peur de la répression, mais celle de la redevabilité. Face à ces prédateurs en cavale, la République joue sa crédibilité, sa capacité à se faire respecter et son autorité morale. Ce texte en décrypte les enjeux profonds, loin des passions, mais avec la fermeté que commande la gravité des faits.
Face à un pays éreinté par l’impunité, le duo Diomaye–Sonko a choisi de remettre la justice au centre de l’action publique. Cette volonté ne se décline ni en slogans de circonstance ni en discours vains. Elle se lit dans les premiers gestes posés, dans les signaux adressés à l’appareil judiciaire, dans les ruptures méthodiques avec les pratiques opaques d’hier. Le Président de la République, dans un entretien accordé à France 24, a été clair : le Sénégal ne reculera pas devant le devoir d’assainissement. Et son Premier ministre, Ousmane Sonko, incarne cette promesse avec constance, détermination et pédagogie. Le rôle de l’exécutif, dans cette phase de redressement, est capital.
Pourtant, la tâche est rude. L’héritage est lourd. Les réseaux de prédation n’ont pas disparu avec l’alternance ; ils se sont repliés, mais continuent d’influencer. À peine les premières convocations judiciaires furent-elles lancées que des stratégies d’évitement se sont multipliées. Certains ont fui, d’autres se sont murés dans un silence méfiant, d’autres encore se sont réinventés en commentateurs zélés de l’actualité. Et dans un renversement aussi tragique qu’absurde, ceux qui défendaient hier l’impunité osent aujourd’hui faire la leçon à la justice.
Le peuple, lui, reste lucide. Il ne demande ni règlements de comptes ni vengeances symboliques. Il veut un pouvoir solide, clair, qui rassure. Il veut que la République ne soit plus un refuge pour les politiques ni un guichet de sortie pour les délinquants en col blanc. Il veut que ceux qui ont géré les biens publics rendent compte de leur gestion. Que ceux qui ont failli en répondent. Que ceux qui ont profité d’un système corrompu ne puissent plus s’y recycler. Le peuple veut que les règles remplacent les rentes, que la vérité triomphe des combines, que l’éthique gouverne la force publique.
Nous sommes sur quelle planète lorsqu’on entend des gens s’égosiller pour défendre des intérêts contraires à la morale et à l’intérêt des communautés ? Comment peut-on légitimer l’évasion de ceux que la République appelle à répondre ? Le silence complice, les alliances de circonstance, les plaidoyers de mauvaise foi : tout cela retarde le moment de la vérité. Celui qui élevait la voix pour défendre les inculpés d’hier est lui-même aujourd’hui visé par des enquêtes. La boucle est bouclée. La République, elle, doit tenir son rang.
Fuir la justice n’est pas une stratégie de défense. C’est un aveu de culpabilité. Et lorsqu’un ancien gestionnaire public prend la tangente au moment où le peuple demande des comptes, c’est moins un acte individuel qu’un symptôme collectif. Il faut se demander : qui savait ? Qui a fermé les yeux ? Qui a laissé faire ? Un fugitif n’est jamais seul. Il est entouré de complicités, d’omissions volontaires, de calculs inavoués. C’est tout un système qu’il faut désarmer.
Le Sénégal ne peut demeurer un pays où la loi vacille et où les portes de l’impunité restent entrouvertes. Il faut impérativement mettre en place un système d’alerte interconnecté avec les pays voisins, avec transmission systématique des signalements, gel conservatoire des avoirs, et déclenchement d’accords de coopération judiciaire. L’Afrique de l’Ouest ne peut plus être un espace d’impunité rotative où les corrompus de Bamako se réfugient à Conakry, ceux de Conakry à Abidjan, et ceux de Dakar dans tous les interstices possibles. La CEDEAO, si elle veut rester crédible, doit faire du respect des mandats judiciaires une priorité partagée.
Les départs précipités observés dès le lendemain de l’alternance ne sont pas des hasards. Ils sont des réponses cyniques à la peur de rendre compte. Derrière chaque billet d’avion, chaque précipitation logistique, il y a un réflexe de survie. Non pas face à la tyrannie, mais face à la justice. Et c’est là que l’enjeu se noue : la justice ne peut plus être un slogan. Elle doit devenir une démonstration quotidienne de souveraineté.
Le Premier ministre Ousmane Sonko, dans ses interventions publiques, a rappelé à plusieurs reprises que la lutte contre l’impunité ne sera pas négociable. Les audits en cours, les enquêtes enclenchées, les signaux envoyés aux corps de contrôle et aux magistrats dessinent une ligne de clarté. Le pouvoir ne veut pas échouer, car l’échec ne serait pas simplement politique : il serait moral, historique, civilisationnel. Ce qui est en jeu, c’est la crédibilité même de l’État.
Des centaines de milliards ont disparu. Pendant que les hôpitaux manquaient de médicaments, des marchés surfacturés servaient à enrichir des clans. Pendant que les étudiants attendaient leurs bourses, des malfaiteurs en col blanc se partageaient nos deniers. Pendant que les contribuables se saignaient, des villas s’achetaient au comptant. Ce n’est pas une simple faute de gestion : c’est une trahison de la nation.
Dans ce contexte, les institutions doivent jouer leur rôle jusqu’au bout. Le Parlement doit revoir les lois qui permettent aujourd’hui à des délinquants économiques de gagner du temps ou de jouer sur les failles du droit. Il revient au Président de la République de faire en sorte que la justice ne soit plus une menace pour les faibles, et une protection pour les puissants. C’est dans ce rétablissement moral que l’autorité de l’État puise sa légitimité.
Le peuple, lui, observe. Il attend. Mais il ne pardonnera pas une seconde trahison.
Ce moment est un tournant. Ou bien la République se redresse, ou bien elle s’effondre à nouveau dans les sables mouvants de l’impunité. Il ne s’agit plus seulement de réprimer, mais de reconstruire. De faire en sorte que plus jamais, un ministre, un directeur, un comptable public ne puisse penser que détourner est un droit, et fuir une option. C’est à cette tâche, exigeante mais noble, que sont appelés ceux qui aujourd’hui ont la charge du pouvoir.
Et c’est là où l’histoire retiendra, non les effets d’annonce, mais les actes. Le courage d’aller jusqu’au bout. L’audace de nommer les fautes. La constance de tenir le cap. Car si les prédateurs prennent la fuite, c’est peut-être parce que, pour la première fois, ils devinent que la République ne reculera pas.
Hady TRAORE
Expert-conseil
Gestion stratégique et Politique Publique-Canada
Fondateur du Think Tank : Ruptures et Perspectives
hadytraore@hotmail.com










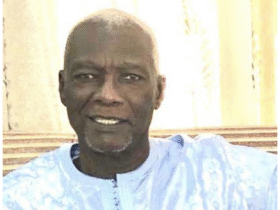



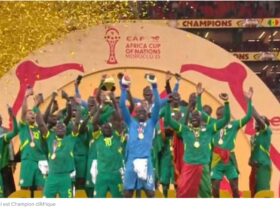
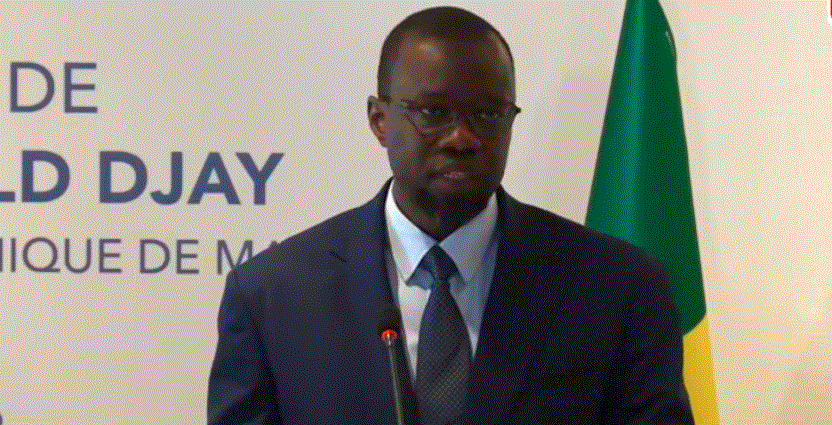


Laisser une Réponse