À l’Assemblée générale de l’ONU, plusieurs chefs d’État africains ont rappelé avec force la nécessité d’une réforme profonde du système multilatéral. Tout en reconnaissant l’importance de l’organisation, ils ont souligné qu’elle demeure trop éloignée des réalités du continent et des préoccupations de ses populations. Ces interventions ont mis en lumière une Afrique déterminée à peser davantage sur les décisions qui façonnent l’ordre mondial.
Denis Sassou-Nguesso a insisté sur l’urgence d’une ONU capable de se rapprocher des citoyens, de mieux comprendre leurs besoins et d’agir avec davantage de réactivité. Dans le même esprit, Bassirou Diomaye Faye a défendu une représentation équitable de l’Afrique au Conseil de sécurité et a appelé à un cadre fiscal mondial plus juste, permettant aux pays du continent de bénéficier pleinement des ressources et des richesses qu’ils génèrent. Faustin-Archange Touadéra a alerté sur l’ampleur des conflits qui continuent de déstabiliser l’Afrique et a demandé un financement durable pour les opérations de paix, rappelant que la sécurité régionale constitue un enjeu mondial.
Par ailleurs, Azali Assoumani a ravivé la question de Mayotte, qu’il a qualifiée de dernière blessure de la décolonisation, soulignant les tensions historiques encore non résolues dans l’océan Indien.
Ces interventions traduisent une ambition collective de l’Afrique qui vise à transformer son rôle sur la scène internationale, faire entendre ses priorités et peser de manière significative sur la gouvernance mondiale. Elles illustrent également la volonté des dirigeants africains d’allier légitimité politique et responsabilité stratégique, en proposant des solutions concrètes pour que l’ONU ne reste pas seulement un forum de discussions, mais devienne un véritable instrument de justice et de solidarité globale.
En affirmant ces positions, l’Afrique envoie un signal clair aux puissances mondiales et aux institutions internationales. Le continent exige de ne plus être considéré comme périphérique et démontre sa capacité à structurer un agenda qui reflète ses intérêts économiques, sociaux et sécuritaires. Cette mobilisation collective laisse entrevoir un multilatéralisme réinventé, où justice, équité et responsabilité partagée seraient enfin au cœur des décisions internationales.









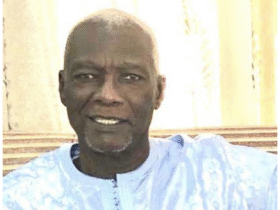





Laisser une Réponse