Arrestations en cascade, enquêtes relancées : le Sénégal vit une rupture inédite où les réseaux d’hier découvrent que l’État n’est plus leur refuge.
L’histoire retiendra peut-être ce moment comme celui où la République a cessé de trembler devant ses propres prédateurs. Ce qui se joue aujourd’hui dépasse le simple cadre judiciaire : c’est la mise à nu d’un système qui, pendant plus d’une décennie, a prospéré sur le silence, la complicité et la démission de l’État. Des fortunes colossales ont été amassées dans l’ombre, amputant les budgets des hôpitaux, des écoles, des infrastructures vitales et de tous ces projets qui auraient pu transformer la vie quotidienne des Sénégalais. Désormais, ces milliards refont surface, convoquant leurs auteurs présumés devant la justice. L’impunité cesse d’être une protection et la reddition des comptes devient l’exigence cardinale de ce temps nouveau.
Cette rupture relève d’une volonté ferme : rompre avec une gouvernance qui avait institutionnalisé le contournement des règles comme mode de gestion. Les signalements de la CENTIF, longtemps relégués aux oubliettes, deviennent aujourd’hui des preuves accablantes et des leviers de refondation. Car l’argent sale n’est pas une simple irrégularité : il a agi comme un virus systémique qui a infecté les rouages de l’État, fissuré la société et perverti l’éthique publique. Là où la corruption s’installe, la République recule. Et ce sont les citoyens les plus vulnérables qui en supportent les conséquences.
Politiquement, le séisme est sans précédent. Le régime des passe-droits, qui transformait l’État en citadelle privatisée, se fissure. Ceux qui imposaient leurs lois dans l’ombre découvrent que l’ère des privilèges est révolue. Ce basculement n’est pas une revanche, mais une réhabilitation de la souveraineté : rappeler que la République n’appartient ni aux lobbies, ni aux clans, ni aux familles, mais au peuple tout entier. À travers ce geste, l’État se réapproprie sa légitimité, et le citoyen redécouvre que la justice peut être impartiale, même lorsqu’elle vise ceux qui, hier encore, semblaient inattaquables.
Sur le plan économique, les effets de cette rupture vont bien au-delà de la récupération des fonds détournés. Chaque franc restitué représente une école à construire, un hôpital à équiper, une route à bitumer. Mais surtout, la mise au jour des détournements dévoile l’ampleur d’une économie fictive, fondée sur l’extraction illicite de ressources. La prévarication a désarticulé l’économie réelle : l’investissement productif a été supplanté par des circuits opaques, l’argent a circulé sans valeur ajoutée, et la masse monétaire a gonflé artificiellement. Cela a provoqué une inflation rampante, une perte de compétitivité, une détérioration du climat des affaires et, en fin de compte, un appauvrissement généralisé des ménages.
À Dakar, cette crise est visible à l’œil nu. Le coût de la vie rivalise avec celui de certaines capitales occidentales. Le mètre carré atteint des niveaux indécents, les loyers explosent, et il n’est plus rare d’entendre qu’un studio coûte désormais plus cher à Dakar qu’à Dubaï. Cette spéculation immobilière, alimentée par des capitaux douteux, a vidé le marché de sa fonction sociale. Résultat : les classes moyennes suffoquent, les jeunes diplômés renoncent à leur autonomie, et les familles les plus modestes sont reléguées aux marges urbaines. Le logement, droit fondamental, est devenu un privilège, pendant que la pierre sert de paravent à la corruption.
Socialement, cette nouvelle ère ouvre une période de réparation. Longtemps, les Sénégalais ont vu les puissants échapper à tout contrôle pendant que les faibles subissaient la rigueur d’un État à deux vitesses. Voir aujourd’hui d’anciens hauts responsables convoqués par la justice provoque un effet de décompression morale. Ce n’est pas une chasse aux sorcières : c’est une exigence d’équité. La jeunesse, surtout, comprend que la moralisation de la vie publique n’est plus un vœu pieux, mais une réalité en construction. Elle découvre que l’État peut protéger plutôt que trahir, sanctionner au lieu de couvrir, et servir au lieu de se servir.
Symboliquement, l’inversion est brutale. Ceux qui vivaient dans l’ivresse des privilèges découvrent l’exposition publique, l’humiliation et la chute. Le crime économique, longtemps banalisé, devient une marque d’infamie. La République change de boussole : désormais, c’est la transparence, la responsabilité et la sobriété qui redonnent sens à l’action publique.
Ce tournant n’aurait pas été possible sans le volontarisme du Président de la République Bassirou Diomaye Faye et du Premier ministre Ousmane Sonko. Leur mérite est immense : ils ont osé là où tant d’autres ont reculé. Ils ont touché aux réseaux qui se croyaient éternels et inviolables. En assumant l’ouverture des dossiers, ils ont fait de la promesse de rupture une ligne de conduite. Leur courage politique redonne chair à l’espérance collective : celle d’un État juste, impartial et redevable.
Mais cette dynamique doit s’inscrire dans la durée. Il faut des enquêtes rigoureuses, des procès équitables, des condamnations, mais surtout des restitutions effectives et une redistribution visible. Ce que le peuple attend, ce sont des hôpitaux réhabilités, des écoles livrées, une justice qui inspire confiance, et un marché où les prix ne soient plus dictés par des fortunes frauduleuses.
C’est ici que la loi sur les lanceurs d’alerte entre en jeu. Votée par la majorité parlementaire, elle marque une avancée décisive dans la sécurisation de la transparence. Trop souvent, ceux qui détenaient l’information étaient bâillonnés par la peur ou menacés par ceux qu’ils osaient dénoncer. Cette loi rétablit l’équilibre. Elle protège les vigiles de l’État, ces citoyens ordinaires devenus extraordinaires par leur sens de l’éthique. Elle confère une légitimité nouvelle à l’alerte, non comme acte de délation, mais comme geste de salubrité républicaine. Et surtout, elle s’applique sans distinction : ni les anciens, ni les actuels dirigeants ne peuvent s’y soustraire. C’est en cela qu’elle garantit la sincérité de la rupture. Elle consacre une ère où nul n’est au-dessus du soupçon ni à l’abri de l’examen. C’est un rempart contre les dérives futures, un filet de sécurité pour l’intégrité.
Ceux qui seront reconnus coupables de détournement ou de blanchiment devront subir des sanctions à la hauteur de l’offense faite à la nation. Il ne suffira plus de restituer une portion du butin pour espérer réintégrer l’espace public. Transiger, c’est minimiser un crime qui a privé des millions de citoyens de soins, d’éducation et d’avenir. La République doit désormais frapper fort, non par vengeance, mais par exigence de justice et d’exemplarité. Car dans un État sain, voler l’argent public n’est pas un accident : c’est une trahison insupportable qui appelle une réponse sans équivoque.
Le Sénégal vit un moment fondateur. La fin des intouchables n’est plus une hypothèse : elle a commencé. Et tant que la volonté politique demeure, rien ne pourra la contenir. En brisant les coffres de l’impunité, la République restaure sa dignité, protège l’avenir et se réconcilie avec son peuple. Les citoyens comprennent désormais qu’un autre Sénégal n’est pas seulement possible : il est en train de naître.
Hady TRAORE
Expert-conseil
Gestion stratégique et Politique Publique-Canada
Fondateur du Think Tank : Ruptures et Perspectives
hadytraore@hotmail.com








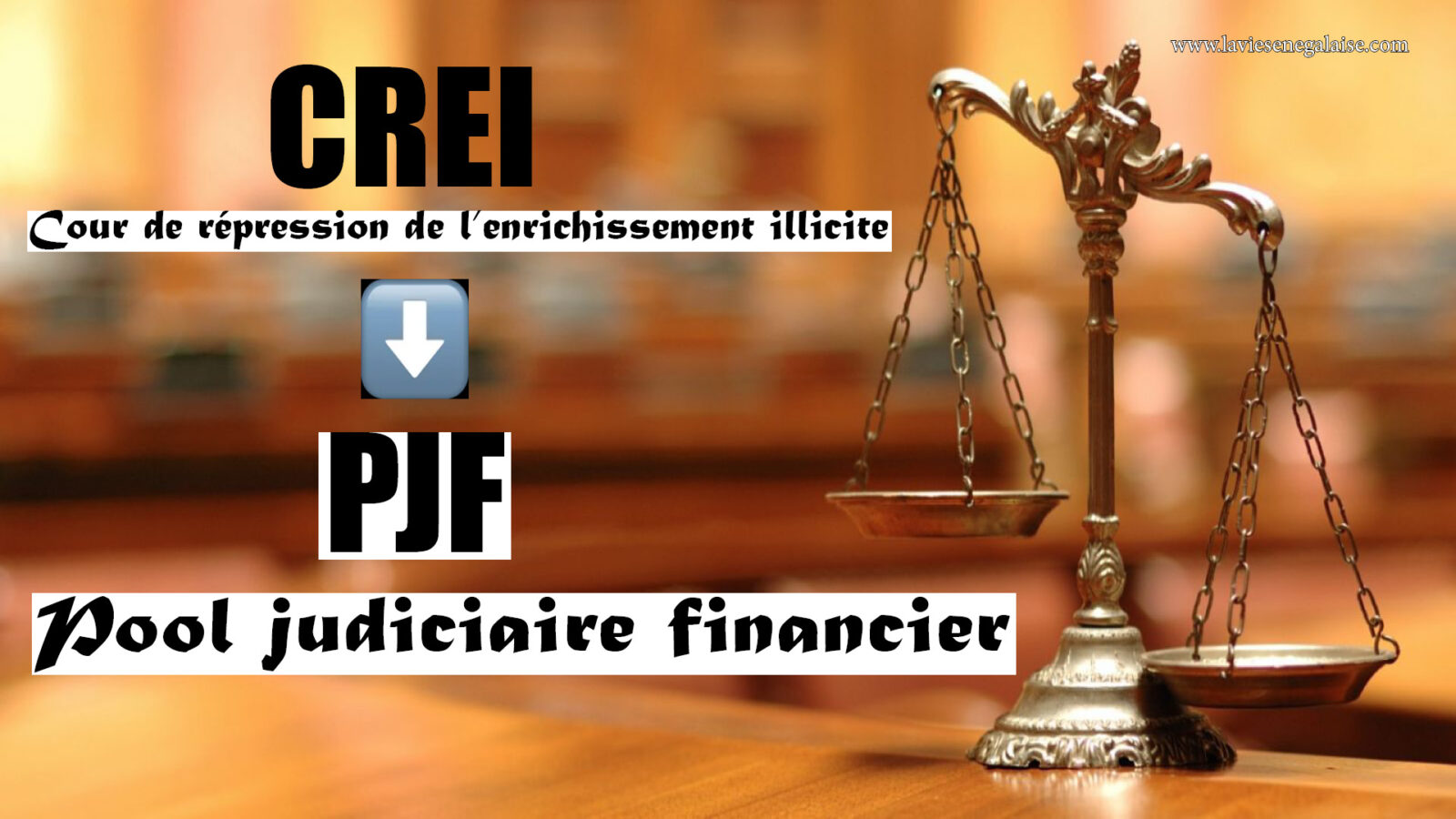

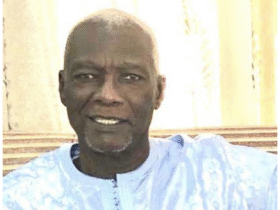




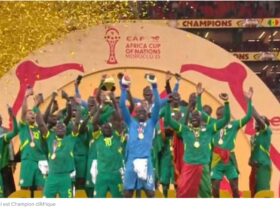
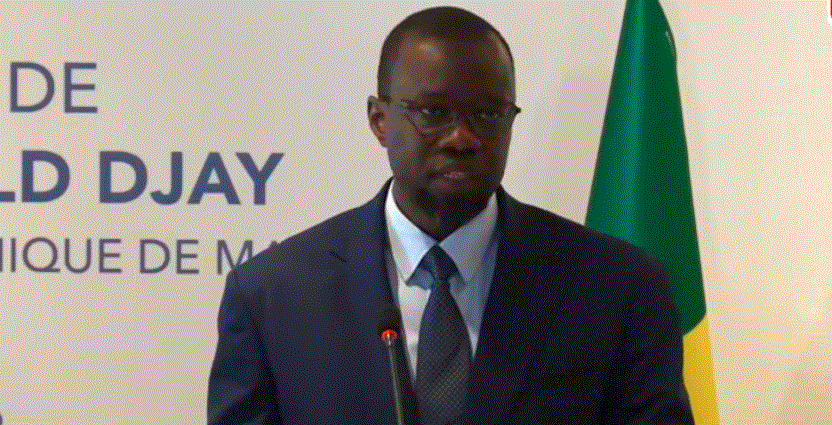

Laisser une Réponse