Il y a des vérités qu’on tait par habitude, par culture ou par peur d’offusquer. À Dakar, on préfère souvent détourner les yeux, enrobant notre passivité dans le doux manteau du « masslaa ». Mais à force de tout tolérer, notre capitale est peu à peu devenue une scène d’anarchie sociale et urbaine où la mendicité est non seulement visible, mais organisée, industrialisée, banalisée.
L’installation de Me Bamba Cissé au ministère de l’Intérieur pourrait marquer un tournant. En s’attaquant dès les premiers jours à la mendicité et à l’occupation anarchique des espaces publics, il lance un signal fort : l’État veut reprendre le contrôle. Et cette fois, il faudra que les discours soient suivis d’actions concrètes, fermes, assumées, quitte à froisser les sensibilités.
Car il faut dire les choses telles qu’elles sont : la mendicité n’est plus un acte de détresse individuelle, elle est devenue un business. À Colobane, aux abords des ponts, sur les terre-pleins centraux, ce sont des familles entières, souvent venues d’ailleurs, qui ont transformé l’espace public en terrain d’exploitation. Le père gère, la mère surveille, les enfants exécutent. Avec une précision quasi-militaire. Ce n’est plus un phénomène social, c’est une entreprise.
Or, la rue n’est pas un lieu de vie. Encore moins un lieu de travail pour des enfants.
Il est donc temps de sortir de l’émotion pour entrer dans l’action. L’argument humanitaire ne peut plus être l’alibi de notre inaction. Tolérer que des enfants dorment sous les ponts ou se faufilent entre les voitures pour quelques pièces, ce n’est pas faire preuve d’empathie. C’est faire preuve de lâcheté collective.
L’État le sait. La loi interdit la mendicité sur la voie publique. Le ministre l’a rappelé. Et le Premier ministre Ousmane Sonko l’avait clairement affirmé : le retrait des enfants de la rue est une priorité nationale. Ce qui signifie qu’il ne s’agit plus d’envisager une énième tentative, mais bien de mettre fin, une bonne fois pour toutes, à une pratique qui viole les droits des enfants, nuit à l’image de notre capitale et mine notre cohésion sociale.
Cela passera par un recensement rigoureux des occupants illégaux, une coordination entre ministères, mais surtout, par une volonté politique constante, à l’abri des pressions émotionnelles ou communautaristes.
Bien entendu, il faudra accompagner les familles, insérer les enfants, réhabiliter les centres d’accueil, mobiliser les travailleurs sociaux, renforcer les coopérations internationales. Mais tout cela ne sera possible qu’à une condition : cesser de se voiler la face.
La Teranga ne peut pas tout justifier. Accueillir ne veut pas dire subir. Et notre hospitalité ne doit pas être le prétexte d’un chaos urbain sans fin. Pour une capitale moderne, propre et sécurisée, il faut du courage. Celui de dire non. Celui d’agir. Celui de mettre de côté l’émotion pour faire triompher l’intérêt général.








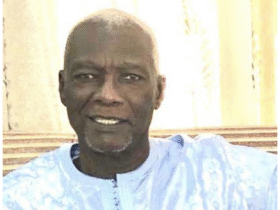



Laisser une Réponse