Il est des débats qui éclairent et d’autres qui obscurcissent. Celui sur la dette publique du Sénégal aurait pu être l’occasion d’une clarification utile ; il a viré à la leçon de suffisance. Dans une sortie relayée par Emedia, M. Cheikh Oumar Diagne a cru bon d’ériger sa parole en vérité absolue, fustigeant ceux qui, selon lui, n’auraient pas les compétences pour aborder ce sujet. En déclarant que « la dette ne pouvait pas être cachée », il a substitué la condescendance à la démonstration, le mépris à la méthode. Mais en économie publique, les certitudes tonitruantes ne valent pas les preuves silencieuses. La science financière ne s’impose pas par le ton : elle s’explique par la rigueur.
Parler de « dette cachée » ne relève ni du sensationnalisme ni du mensonge. C’est une notion établie, utilisée par le FMI, la Banque mondiale et toutes les institutions de notation souveraine. Elle désigne les engagements financiers d’un État non consolidés dans la dette officielle, souvent portés par des entités publiques, parapubliques ou des sociétés d’État. Ces dettes “hors bilan” ne sont pas invisibles, mais elles échappent au périmètre statistique de la dette centrale. Elles deviennent donc « cachées » non parce qu’elles sont secrètes, mais parce qu’elles ne figurent pas dans la comptabilité consolidée. Les cas du Mozambique en 2016, du Ghana en 2022 ou encore du Tchad en 2018 ont démontré comment ces passifs périphériques peuvent se transformer en crise nationale. Parler de dette cachée, c’est parler de transparence comptable, non d’accusation politique.
C’est ici que l’argument de M. Diagne vacille. Affirmer que la dette « ne pouvait pas être cachée au FMI ni à la BCEAO » traduit une confusion élémentaire sur le rôle de ces institutions. Ni le FMI ni la BCEAO n’ont accès, de façon indépendante, à la comptabilité détaillée des États. Leurs chiffres reposent sur les déclarations officielles transmises par les administrations nationales. Le FMI ne vérifie pas la sincérité budgétaire : il part du principe qu’elle existe. La BCEAO, pour sa part, ne suit que les expositions bancaires agrégées, non les dettes contractuelles ou les garanties croisées entre entités publiques. En d’autres termes, ce qui est connu en interne n’est pas nécessairement consolidé dans les statistiques internationales. C’est cette dissociation entre la connaissance technique et la publication officielle qui fonde précisément la notion de dette cachée.
Cheikh Oumar Diagne confond ainsi la connaissance administrative avec la transparence comptable, et l’existence juridique d’une dette avec sa visibilité statistique. Il cite les écarts entre la Direction de la Dette Publique (DDP) et la Direction des Opérations de Dette Publique (DODP) comme preuve que « tout était connu ». C’est une erreur. Ces divergences ne démontrent pas la transparence : elles en révèlent les fractures. Elles traduisent une désarticulation institutionnelle entre les structures chargées du suivi de la dette, DDP, DODP, DGCPT, DGID, DGPPE et justifient aujourd’hui la réforme structurelle du dispositif. Le terme “cachée” ne vise donc pas un mensonge politique, mais un déficit de coordination et de consolidation. Nier cette réalité, c’est refuser de voir le problème de gouvernance budgétaire qui s’impose à nous.
Ce que M. Diagne refuse de voir, c’est que le débat sur la dette cachée n’a pas été ouvert pour accabler l’État, mais pour assainir sa mémoire. Les écarts identifiés entre les directions et les institutions financières ne sont pas nés en 2024 : ils sont l’héritage d’une décennie d’opacité, de dérives comptables et de déresponsabilisation progressive des organes de contrôle. Ce gouvernement n’a pas inventé la dette cachée, il l’a mise au jour. Il a choisi la transparence là où d’autres avaient choisi la dissimulation comptable. En cela, la rupture est déjà visible : ce n’est plus l’État qui se cache de ses chiffres, mais les chiffres qui reviennent au service de l’État.
Autre approximation : assimiler les montages financiers complexes : partenariats public-privé, dettes garanties, prêts bancaires refinancés ou arriérés consolidés à des emprunts classiques. Ces instruments génèrent des risques budgétaires différés, qui n’apparaissent qu’à la maturité des contrats ou à l’exécution des garanties. Ils ne sont pas de la dette explicite, mais ils en produisent les effets différés. Là encore, parler de dette cachée n’a rien d’abusif : c’est reconnaître la part d’ombre comptable de ces montages. Le gouvernement actuel a eu raison d’en exiger l’audit complet et la consolidation dans un périmètre unique. La transparence commence là où s’arrête la fragmentation des chiffres.
Quant à la déclaration de M. Diagne selon laquelle il aurait été « le premier à évaluer la dette à 116 % du PIB », elle ne résiste à aucun examen méthodologique. Ce chiffre, lancé sans base claire, mélange probablement les engagements bancaires, les arriérés intérieurs et les dettes commerciales à court terme avec la dette publique consolidée. La mesure d’un ratio dette/PIB n’est pas un acte d’imagination : c’est un exercice normé. Les conventions internationales distinguent la dette brute, la dette nette et les engagements contingents. Les additionner indistinctement relève de la confusion, non de l’expertise. En économie, la rigueur n’est pas un luxe : c’est la seule politesse due au réel.
Le FMI et la BCEAO, contrairement à ce qu’il affirme, ne sont ni des commissaires aux comptes ni des juges de sincérité budgétaire. Leurs missions consistent à analyser, non à auditer. Ils se basent sur les données que leur communiquent les États, et leurs rapports n’ont pas valeur de certification. La sincérité statistique reste donc une responsabilité nationale. En décidant de réévaluer et d’unifier les chiffres de la dette, le gouvernement du Sénégal n’a pas cherché à “inventer” un problème : il a assumé son devoir de vérité. Car il n’y a pas de confiance publique sans cohérence comptable.
Le débat véritable n’est donc pas de savoir si la dette a été “cachée” ou non, mais si elle a été maîtrisée. La question essentielle n’est pas sémantique : elle est institutionnelle. Ce qui importe désormais, c’est de doter le pays d’une architecture de suivi cohérente, par exemple une Agence nationale de la dette, un cadastre des garanties et un reporting consolidé. Le reste n’est que distraction rhétorique. La crédibilité financière d’un État ne se mesure pas à la virulence de ses polémistes, mais à la traçabilité de ses engagements.
On ne protège pas la vérité économique par le mépris. On la sert par la précision. Ceux qui brandissent le dédain comme argument trahissent leur propre fragilité intellectuelle. Comprendre la dette, c’est accepter sa complexité et reconnaître la part d’ombre que toute comptabilité publique recèle. Le savoir, dans ce domaine, n’est pas un privilège : c’est un service. Et ce service suppose de l’humilité. Le vrai courage intellectuel ne consiste pas à dire “taisez-vous”, mais à parler juste, avec mesure, méthode et responsabilité.
Hady TRAORE
Expert-conseil
Gestion stratégique et Politique Publique-Canada
Fondateur du Think Tank : Ruptures et Perspectives
hadytraore@hotmail.com









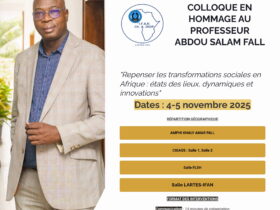
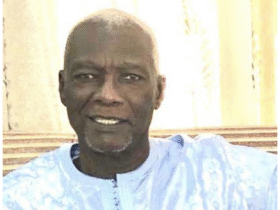



Laisser une Réponse