« Je voudrais tout d’abord rendre hommage aux autorités sénégalaises qui ont eu le mérite de mettre au jour un important problème de fausse déclaration. Il s’agissait d’une dette dissimulée, et elles ont eu le courage de la révéler. Il a fallu du temps pour comprendre pourquoi cela s’était produit, en mesurer l’ampleur et déterminer la marche à suivre. Mais aujourd’hui, la situation est claire. »
Kristalina Georgieva, Directrice générale du FMI, 16 octobre 2025
Ces mots sont un aveu planétaire, une reconnaissance officielle de la dissimulation, un tournant diplomatique aux répercussions majeures. Pour la première fois, une haute autorité financière mondiale admet publiquement qu’un pays africain a été victime d’un camouflage budgétaire dont il n’était pas l’auteur. Et si l’on poussait cette logique jusqu’au bout ? Et si, à partir de cette phrase, le Sénégal décidait d’écrire une toute nouvelle page ?
Car si la situation est claire, comme l’a dit la Directrice du FMI, alors elle appelle des suites claires. Il ne suffit pas de saluer le courage des autorités actuelles. Il faut réparer les conséquences de la faute reconnue. Ce que le Sénégal a mis au jour, c’est plus qu’un chiffre caché : c’est un système de gouvernance trahi, une architecture budgétaire violée, un contrat démocratique piétiné.
Dès lors, l’après doit être à la hauteur de l’aveu. Et le Sénégal ne peut pas rater ce rendez-vous. Il lui faut transformer cette reconnaissance internationale en levier de souveraineté, non seulement symbolique mais institutionnelle. Cela implique une relecture complète du contrat budgétaire national, une réécriture des normes de transparence, et une consolidation de la reddition des comptes. Cela commence par un geste fort : exiger du FMI non pas une compensation financière immédiate, mais une codécision sur les termes du traitement de cette dette dissimulée. L’institution qui l’a validée, même involontairement, doit aujourd’hui co-construire la solution. C’est une question de principe, de respect et de crédibilité partagée.
Mais il serait réducteur de penser cette séquence comme une simple rectification. Il faut la voir comme une matrice. Un point de bascule. Le Sénégal a aujourd’hui l’opportunité unique de créer un précédent continental, voire mondial. Il peut faire de cette crise le socle d’une doctrine inédite : la doctrine sénégalaise de la dette transparente. Une doctrine constitutionnelle selon laquelle toute dette contractée sans débat parlementaire, sans publication et sans étude d’impact indépendante, est frappée d’illégitimité. Ce principe ne doit pas rester abstrait : il doit s’incarner dans les pratiques, se traduire dans les circuits de décision, irriguer les réflexes administratifs. C’est à ce prix que naîtra une culture de la responsabilité durable.
Une telle doctrine appelle des instruments. Le Sénégal pourrait créer une juridiction constitutionnelle de la dette, rattachée au Conseil constitutionnel ou constituée en chambre autonome, chargée d’examiner la conformité de tout engagement financier majeur avec les principes démocratiques et de souveraineté budgétaire. Elle serait saisie automatiquement pour toute dette dépassant un seuil fixé dans la Constitution.
Il pourrait également instituer une commission permanente d’alerte budgétaire, composée de magistrats financiers, d’experts indépendants et de représentants de l’Assemblée nationale, nommés. Cette instance publierait tous les trimestres un rapport public sur l’état de l’endettement et les engagements futurs de l’État. Elle disposerait d’un droit de saisine directe de l’Assemblée nationale en cas d’alerte grave ou de risque de dissimulation. Une autorité de contrôle parlementaire adossée à cette commission renforcerait sa portée opérationnelle et sa légitimité démocratique.
Il faut également penser à l’avenir. Que cette dette dissimulée devienne un cas d’école, intégré dans les programmes scolaires et universitaires. On pourrait imaginer un module obligatoire au baccalauréat sur la dette publique et la gouvernance, ou un cours interdisciplinaire à l’université, croisant économie, droit public et éthique de la gestion publique. Car il ne s’agit pas seulement de réparer, mais d’éduquer. De forger une conscience nationale de la dette. De faire comprendre à chaque jeune Sénégalais que l’endettement est un acte politique, moral et générationnel.
En cela, le Sénégal pourrait s’inspirer de l’expérience de l’Équateur en 2008, qui, après un audit citoyen, avait déclaré illégitime une partie de sa dette extérieure, obtenant une renégociation en profondeur. Ce précédent montre qu’il existe des voies politiques de réappropriation de la souveraineté budgétaire, à condition de les penser avec méthode, légitimité et courage.
Une innovation majeure serait d’imposer à chaque ministre concerné par les finances publiques la signature d’une charte individuelle de responsabilité budgétaire. Ce document, publié en ligne, serait un engagement personnel à la transparence, à la sincérité des actes et à la traçabilité des choix. Il pourrait même être adossé à des sanctions politiques et pénales en cas de manquement grave. Un organe de suivi parlementaire serait institué pour veiller au respect de ces engagements et publier un rapport annuel soumis au débat de l’Assemblée nationale.
Quant aux institutions régionales, le Sénégal gagnerait à porter cette doctrine au sein de l’Union africaine, de la ZLECAf et du Conseil économique africain. Il pourrait proposer un Traité panafricain de transparence budgétaire, instituant une instance de régulation continentale, dotée d’un pouvoir d’alerte et de signalement, inspirée de la Cour africaine des droits de l’homme.
Et si le Sénégal allait plus loin encore ? Et s’il proposait un Sommet international pour la dette responsable, réunissant des États, des institutions financières (Banque mondiale, FMI, BAD), des juristes, des prix Nobel d’économie, des universités de référence, pour adopter un Pacte mondial pour la transparence de l’endettement public ? Il serait la première pierre d’une gouvernance budgétaire mondiale fondée sur la transparence et l’éthique. Une initiative portée par un pays africain. Une démonstration que l’Afrique ne demande pas la charité budgétaire, mais revendique une souveraineté construite sur l’exemplarité.
Quant au FMI, il ne peut se dérober. La reconnaissance du 16 octobre n’est pas une fin, c’est un commencement. Il lui revient, par devoir éthique, de soutenir, techniquement, politiquement, institutionnellement, la construction de ce nouveau cadre. Il pourrait, par exemple, financer un fonds d’appui à la gouvernance budgétaire souveraine, dédié au développement d’outils de veille financière, à la formation des administrations publiques, à l’audit des engagements passés et à la production de rapports citoyens multilingues sur la dette.
Car au fond, la vraie rupture ne réside pas dans l’aveu, mais dans ce qu’on décide d’en faire. Si l’Histoire devait retenir un instant, ce ne serait pas celui de la dette dissimulée, mais celui d’un sursaut : celui d’un pays qui aura transformé la faute en socle de réforme. Alors la vérité ne flottera plus du côté des faux-semblants, mais s’enracinera dans le courage de nommer, de réparer, de reconstruire. On dira que le Sénégal n’a pas fui l’injustice, il l’a retournée.
Hady TRAORE
Expert-conseil
Gestion stratégique et Politique Publique-Canada
Fondateur du Think Tank : Ruptures et Perspectives
hadytraore@hotmail.com












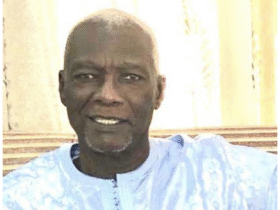



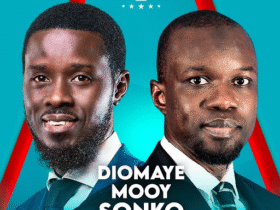



Laisser une Réponse