Mais aujourd’hui, l’hésitation des bailleurs classiques dans un monde en crise de ressources impose un modèle de financement alternatif. Ce qui ne doit pas nous faire oublier que le Sénégal ne peut bâtir son avenir uniquement sur des transferts de fonds destinés à la consommation ou à l’investissement immobilier. Il est temps que ces ressources soient orientées vers des projets structurants portés par l’État. Cela implique un sacrifice : les émigrés devront renoncer, en partie, à des investissements personnels pour souscrire à des obligations nationales, à des fonds souverains ou à des projets d’infrastructure. Ce n’est pas une simple contribution, c’est un acte de foi envers la nation.
Cependant, cette exigence ne peut être unilatérale. Les Sénégalais d’ici et de la diaspora ne doivent pas être les seuls à serrer la ceinture. L’État, lui aussi, doit montrer l’exemple. Il est inadmissible que, dans un contexte de mobilisation nationale, le train de vie des dirigeants reste inchangé. Les voyages en jet privé du Premier ministre, les déplacements coûteux et peu productifs du Président, ainsi que les dépenses superflues des hauts responsables doivent être les premiers leviers d’une nouvelle doctrine de sobriété.
La pédagogie par l’exemple est un langage puissant. Elle inspire confiance, elle fédère, elle légitime l’effort collectif. Si l’État veut convaincre ses enfants de l’extérieur d’investir dans le destin du Sénégal, il doit d’abord leur prouver que chaque franc mobilisé sera utilisé avec rigueur, transparence et efficacité.
Le développement ne se décrète pas, il se construit ensemble dans l’équité, la responsabilité et le respect mutuel.












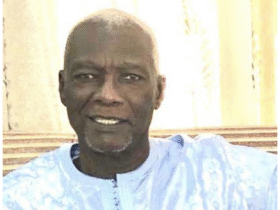



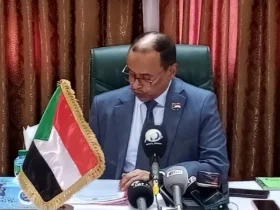


Laisser une Réponse