Sous le masque de la liberté de la presse, c’est une vieille habitude qui refait surface: celle de l’impunité médiatique. La dernière polémique n’a pas révélé une presse opprimée, mais une presse dévoyée, qui confond le droit de dire avec le droit de tout faire. Ce texte démonte le récit d’une manipulation devenue réflexe.
Parfois, l’actualité nous tend un miroir. Non pas celui des émotions superficielles, mais celui, plus exigeant, des principes républicains. L’affaire née de la tentative de diffusion, sur 7TV, d’une interview exclusive de Madiambal Diagne appartient à cette catégorie. Ce qui aurait pu n’être qu’un banal incident médiatique s’est mué en révélateur puissant, dévoilant des lignes de tension plus anciennes : autour du rôle de la presse, des frontières de la liberté d’expression, de la robustesse des institutions, et de la hauteur républicaine de l’État dans la gestion des tensions.
Le prétexte journalistique au service d’une stratégie d’évitement
Madiambal Diagne est poursuivi pour des faits graves de droit commun. Le mandat d’arrêt international qui le vise s’inscrit dans une affaire de rétrocessions suspectes, impliquant des flux financiers opaques entre sociétés privées, notamment Ellypse Project. Les montants en jeu, plus de 32 millions d’euros, soit plus de 21 milliards CFA, relèvent d’enjeux financiers, non éditoriaux. Ce n’est pas un différend journalistique : c’est une affaire présumée de détournement, de blanchiment et de concussion. Il est donc recherché en tant qu’homme d’affaires, pas en tant que journaliste.
Et pourtant, par un retournement stratégique, il tente de revêtir à nouveau les habits du chroniqueur, de l’observateur, du professionnel de la plume. Il ne s’exprime pas depuis une rédaction, mais depuis l’exil. Ce n’est pas sa liberté de ton qui est en jeu, mais sa responsabilité pénale. Cette tentative de requalification médiatique vise à produire un glissement symbolique : celui qui consiste à échanger la figure du prévenu contre celle du persécuté. Ce n’est pas une défense. C’est une mise en scène. Et dans cette opération, certains relais médiatiques deviennent les figurants d’un récit fabriqué.
La connivence implicite d’une partie de la presse
Une frange du paysage médiatique a emboîté le pas, par réflexe plus que par réflexion. Dès qu’un journaliste est inquiété, une partie de la corporation brandit mécaniquement le drapeau de la « liberté de la presse », comme si ce principe fondamental devait exonérer de toute responsabilité individuelle. Cette confusion, répétée à chaque crise, finit par affaiblir la crédibilité même de ce combat. Défendre la liberté d’informer n’a jamais signifié défendre l’irresponsabilité d’informer. Or, c’est bien ce glissement dangereux qui s’est produit : un acte professionnel discutable, clairement contraire aux règles de déontologie, s’est soudain mué en « cause nationale ».
On a crié à la censure, sans interroger le geste initial. On a invoqué la démocratie, sans rappeler la loi. On a fait de la désobéissance médiatique une victoire morale, comme si enfreindre les règles devenait un acte de courage. Voilà la véritable perversion du débat : quand la transgression se déguise en héroïsme, et que la faute devient drapeau. Ce réflexe corporatiste transforme la presse en forteresse refermée sur elle-même. Au lieu de distinguer les causes justes des postures commodes, elle s’enferme dans une solidarité qui confond la confraternité avec l’impunité.
Ce n’est pas la liberté qui était menacée, c’était la responsabilité qui était rappelée. Et refuser de le reconnaître, c’est fragiliser le socle même de la légitimité journalistique. Car la liberté d’informer, pour demeurer crédible, suppose une rigueur morale égale à celle qu’elle exige de l’État. On ne peut pas réclamer la transparence des pouvoirs tout en refusant celle des rédactions. La liberté ne vaut que si elle s’exerce avec conscience ; sinon, elle se dissout dans le vacarme des indignations sélectives.
La mémoire courte et l’indignation sélective
Pourquoi cette même presse, si prompte à s’indigner aujourd’hui, gardait-elle un silence pesant lorsque, sous l’ancien régime, des journalistes d’investigation étaient arrêtés, brutalisés ou interdits d’antenne pour avoir révélé de vrais scandales ? Pourquoi ce double standard qui transforme en symbole de liberté chaque incident impliquant une figure médiatique, tout en oubliant ceux qui ont payé le prix fort pour leur intégrité ?
Il est une constante en politique : lorsque les institutions se ressaisissent, ceux qui les avaient affaiblies crient au scandale. Ils invoquent les libertés, non pour les défendre, mais pour les détourner. On mobilise la liberté d’expression pour protéger des manquements professionnels. On convertit une faute en combat pour la démocratie. On brouille les repères, on manipule les affects.
Mais un État digne de ce nom ne peut se laisser piéger par ces retournements moraux. Il ne peut permettre que ses principes soient retournés contre lui. Car à ce jeu, c’est la vérité qui vacille. Et avec elle, la confiance dans l’institution judiciaire. Or la justice n’est pas un décor de débat médiatique : elle est un pilier de la République. Et elle ne se plie pas aux narratifs fabriqués.
Une fermeté assumée, mais à expliciter davantage
L’État n’a pas reculé. Il a fait appliquer la loi. Mais dans cette séquence, il aurait gagné à expliciter davantage son action. En interrompant la diffusion et en procédant à des interpellations, il a affirmé son autorité. Ce geste fort, cependant, aurait pu être accompagné d’une parole claire et pédagogique. Car faire respecter l’ordre n’exclut ni la transparence ni la mesure. Et contenir une provocation ne suppose pas d’en épouser le bruit.
Ce que la situation exige, ce n’est pas la riposte, mais une attitude républicaine faite de fermeté tranquille et de maîtrise politique.
Pendant ce temps, de vraies avancées reléguées au second plan
Pendant que le tumulte enfle autour d’un pseudo-scandale, des annonces majeures ont été noyées dans le bruit. Le Premier ministre Ousmane Sonko a annoncé une baisse imminente du prix de l’électricité, du gaz et du carburant, soulageant directement les budgets des ménages. Le ministre de l’Agriculture, en tournée dans les zones rurales, a délivré un message porteur d’espoir : des productions record attendues dans toutes les spéculations, grâce à une campagne maîtrisée. Et le Président de la République vient de dévoiler la mascotte officielle des JOJ 2026, projetant Dakar et le Sénégal au cœur du monde olympique.
Que de bonnes nouvelles éclipsées. Mais les faits, eux, résistent à la poussière. Le pays avance. Lentement, mais sûrement. Et pendant que certains cherchent l’agitation, d’autres construisent, gouvernent, livrent. Ici, la parole publique ne s’impose pas par le fracas, mais par les résultats. Et cette constance dans l’action finira, comme toujours, par triompher du bruit.
Réhabiliter l’éthique, restaurer la confiance
Ce texte n’est pas un réquisitoire contre toute la presse. Beaucoup de journalistes, rigoureux, professionnels, engagés, honorent leur métier. Mais il faut désormais tracer la ligne. Le journalisme d’intérêt public n’a rien à voir avec le sensationnalisme intéressé. La liberté de la presse n’est pas un refuge pour les faux scoops ni une protection contre la responsabilité.
La presse doit choisir : être gardienne de la vérité ou complice des arrangements. Retrouver le sens du devoir. Refuser les compromissions. Rejeter les figures douteuses. Et surtout, cesser de confondre tribune et tribunal. Car si elle prétend parler au nom du peuple, elle doit aussi répondre aux exigences de probité que cela implique.
Et dans cette affaire, que chacun assume ses responsabilités. La République, elle, continuera son chemin.
Hady TRAORE
Expert-conseil
Gestion stratégique et Politique Publique-Canada
Fondateur du Think Tank : Ruptures et Perspectives
hadytraore@hotmail.com










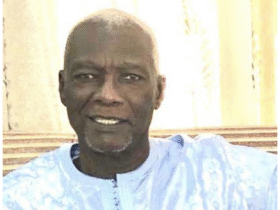



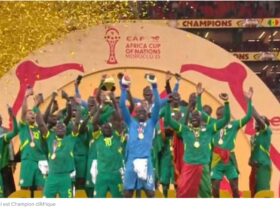
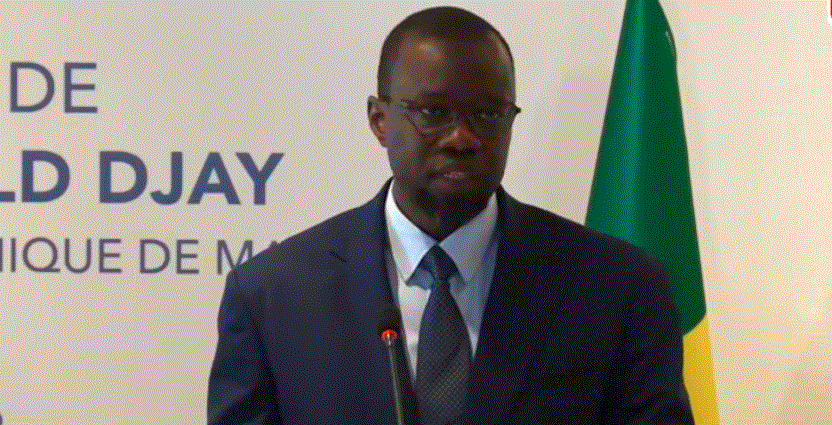


Laisser une Réponse