La République ne se juge pas seulement à ses lois, mais à la manière dont elle traite ses voix discordantes. En convoquant des acteurs politiques pour des faits ouvertement politiques, le pouvoir flirte avec une ligne rouge qu’il avait juré de ne plus jamais franchir. Il ne s’agit pas de faire procès, mais mémoire. Tenir la ligne, c’est éviter que la justice ne devienne, même malgré elle, un écho d’un passé que le peuple a balayé.
Le Sénégal n’est pas en crise. Mais le Sénégal est en observation. Depuis quelques semaines, des signaux faibles, mais répétés, attirent l’attention de tous ceux qui tiennent à la République : convocations judiciaires, interpellations médiatisées, tensions verbales, et sentiment diffus que le débat se déplace, peu à peu, du terrain des idées vers celui des dossiers. Rien de spectaculaire, rien d’irréversible. Mais des gestes, des enchaînements, des perceptions qui, à défaut d’être graves, méritent d’être scrutés avec lucidité.
Ce n’est pas la justice qu’il faut redouter. C’est la tentation du raccourci. La promesse du 24 mars n’était pas seulement de réparer l’injustice, mais d’assainir les pratiques. Et dans cet assainissement, il ne s’agit pas seulement de sanctionner les crimes économiques. Il s’agit aussi de reconstruire la confiance entre gouvernants et gouvernés, en évitant que la justice ne soit perçue, à tort ou à raison, comme un levier politique. Chaque convocation peut être fondée. Chaque enquête peut être légitime. Mais dans un pays qui revient de loin, la perception compte autant que le fond. La justice ne doit pas seulement être impartiale ; elle doit l’apparaître clairement.
Car la République est un équilibre. Entre autorité et dialogue. Entre vérité et pluralisme. Gouverner, ce n’est pas faire taire. Gouverner, c’est écouter, arbitrer, convaincre, et parfois tolérer l’excès pour éviter l’érosion de la confiance. L’opposition, dans une démocratie adulte, n’est pas une menace à contenir, mais une nécessité à reconnaître. Elle est la part critique de la souveraineté populaire. L’affaiblir, c’est appauvrir le débat. La respecter, c’est fortifier le pouvoir.
Il y a, dans ce que nous vivons, un appel à la vigilance. Non pas contre un péril imminent, mais contre une pente. Celle que nous avons connue, et que nous avons rejetée. Celle des amalgames, des arrestations sélectives, des procédures instrumentalisées. Il ne s’agit pas de comparer, ni d’accuser. Il s’agit de rappeler que les principes ne se testent pas uniquement dans l’opposition, mais d’abord dans l’exercice du pouvoir.
Dans cette configuration, le rôle du Premier ministre est central. Parce qu’il incarne, au cœur de l’appareil d’État, le souffle de la refondation. Parce qu’il porte, dans son récit personnel, la mémoire de l’arbitraire subi. Et parce qu’il sait, mieux que quiconque, que la légitimité ne protège pas de la dérive si elle n’est pas constamment interrogée. Tenir la ligne, pour lui, ce n’est pas reculer devant la justice. C’est lui offrir l’espace d’une action libre, sereine, mais incontestable.
La ligne est fine, mais elle existe. Ne pas l’abandonner à l’émotion. Ne pas la tordre pour des urgences conjoncturelles. Ne pas en faire une arme, même discrète. Car une démocratie qui commence à convoquer ses opposants doit se souvenir qu’elle a, hier encore, crié pour que cela cesse. Et qu’aucun projet de rupture ne survivra longtemps s’il commence à ressembler, ne serait-ce que dans les apparences, à ce qu’il a combattu.
Heureusement, des signaux inverses existent. Des dossiers classés sans suite. Des magistrats qui travaillent avec méthode. Une opinion publique vigilante, mais loyale. Rien n’est perdu, car rien n’est encore abîmé. Mais tout doit désormais être pesé.
Le Sénégal n’a pas besoin de prouver sa force, mais de confirmer sa différence. C’est dans l’élégance de la retenue, dans la clarté des procédures, dans le refus des automatismes que se construira la confiance nouvelle. C’est en garantissant le débat que le pouvoir prouve sa maturité. Et c’est dans cette maturité que la rupture cessera d’être un slogan pour devenir une République en actes.
La vigilance démocratique n’est pas un luxe d’intellectuels. C’est une exigence de stabilité. Un pays qui a souffert des restrictions de libertés, de l’arbitraire judiciaire et du rétrécissement de l’espace public sait qu’aucun régime n’est à l’abri d’une dérive s’il relâche la rigueur de ses principes. Le respect scrupuleux des contre-pouvoirs, la séparation effective des rôles et la tolérance assumée au débat contradictoire ne sont pas des concessions. Ce sont des fondations.
D’ailleurs, il ne s’agit pas d’absoudre quiconque au nom de son statut d’opposant, ni d’inhiber les institutions judiciaires lorsqu’un fait répréhensible est identifié. Mais dans une démocratie en reconstruction, la manière, le moment et le message comptent tout autant que la matière. Le procès de l’intention est parfois plus destructeur que l’intention elle-même. D’où l’impératif d’une justice à la fois sereine et désarmante.
Ce qui se joue ici, ce n’est pas un arbitrage entre faiblesse et fermeté. C’est une démonstration de maturité. Faire taire les insultes, contenir les outrances, assainir les échanges : oui. Mais sans jamais basculer dans la répression de l’expression. Le peuple sénégalais, qui a arraché dans le tumulte les promesses de la refondation, n’attend pas un pouvoir dur. Il attend un pouvoir juste, digne, constant et exemplaire.
C’est pourquoi il faut, dans cette phase délicate, bannir les invectives, éviter les querelles de personnes, et revenir au fond du débat : que propose-t-on pour ce pays ? Où voulons-nous aller collectivement ? Et comment gérer l’altérité sans suspicion, sans violence, sans réduction de l’autre à son passé ou à son camp ? C’est par la hauteur du débat qu’un régime se distingue, pas par la vigueur des rappels à l’ordre.
La société sénégalaise a montré sa maturité. Elle ne se laisse plus duper par les récits unidimensionnels. Elle scrute, compare, juge et tire les conséquences. Elle sait faire la part des choses entre la justice nécessaire et l’instrumentalisation insidieuse. C’est pourquoi le pouvoir actuel, s’il veut préserver cette confiance rare, doit toujours faire un pas de plus que les régimes précédents dans la transparence, l’équité et la pédagogie des décisions.
Mais l’opposition, elle aussi, a une responsabilité historique. Celle de ne pas rejouer les scènes d’un théâtre convenu où tout acte du pouvoir est systématiquement soupçonné, caricaturé, ou disqualifié par réflexe. La République ne peut pas se bâtir dans l’outrance permanente, l’indignation de convenance ou la posture victimaire érigée en stratégie. Ceux qui aspirent à gouverner demain doivent aussi élever le débat, proposer, argumenter, respecter les institutions tout en les interpellant. Être opposant n’est pas un permis de provoquer. C’est une charge démocratique, un exercice d’exemplarité dans la contradiction.
Enfin, il faut saluer les signaux qui indiquent qu’un autre rapport à la justice est possible. Des affaires classées sans suite, des convocations suspendues, des précautions prises pour éviter les erreurs du passé : ce sont là des indices que l’État veut tenir sa ligne. Mais cette ligne n’est pas acquise. Elle se mérite. Elle s’ajuste chaque jour à l’épreuve du réel, dans la cohérence des actes et dans l’éthique des moyens. L’autorité n’est grande que lorsqu’elle s’exerce sans soupçon. Et la République ne grandit que dans l’épreuve de la pluralité.
Hady TRAORE
Expert-conseil
Gestion stratégique et Politique Publique-Canada
Fondateur du Think Tank : Ruptures et Perspectives
hadytraore@hotmail.com










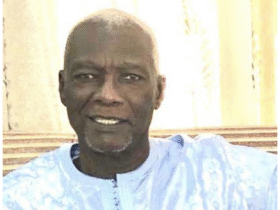




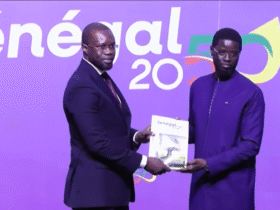

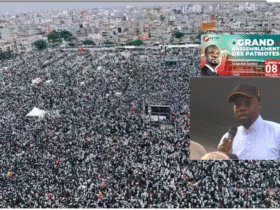
Laisser une Réponse