On accuse la pluie, mais c’est la ville qui s’effondre. On blâme l’État, mais c’est la société qui se condamne. Au Sénégal, les milliards injectés dans les plans anti-inondations n’ont rien changé : chaque saison des pluies rappelle l’urgence d’une rupture. Car ce qui se joue désormais dépasse les canalisations et les bassins de rétention : c’est notre capacité à nous penser comme une communauté responsable.
Chaque année, la scène se répète avec une régularité glaçante : Dakar, les Parcelles Assainies, Pikine, Guédiawaye, Saint-Louis, Kaolack, Fanaye, Touba… Partout, les mêmes images : quartiers submergés, familles déplacées, routes coupées, commerces détruits. Chaque saison des pluies ramène le pays face à son incapacité chronique à prévenir une tragédie annoncée. Depuis le lancement du plan décennal de lutte contre les inondations en 2012, plus de 1 200 milliards de F CFA ont été mobilisés pour construire des bassins de rétention, poser des canalisations, améliorer le drainage et renforcer l’assainissement. Les collectivités locales, les ONG et les bailleurs internationaux ont contribué massivement. Pourtant, chaque année, les eaux montent, les mêmes foyers se retrouvent piégés, les mêmes écoles fermées, les mêmes promesses ressassées. La répétition du désastre est devenue insupportable.
La pluie seule n’explique pas cette impasse. Ce qui se joue est plus profond : une crise comportementale qui traverse l’ensemble de la société. L’“homo senegalesis”, acteur central de cette tragédie, refuse trop souvent de se considérer comme partie prenante des solutions. Les canaux sont bouchés par des déchets déversés par les riverains eux-mêmes ; les bassins de rétention sont remblayés pour devenir des terrains constructibles ; les permis sont délivrés dans des zones à haut risque par des municipalités parfois complices ; les passages naturels des eaux sont obstrués par des constructions illégales. Aux Parcelles Assainies, vitrine censée incarner la réussite d’une urbanisation planifiée, les réseaux de drainage sont saturés. À Touba, l’expansion incontrôlée d’une ville religieuse surpeuplée fragilise chaque saison un peu plus la sécurité des habitants. À Fanaye, l’insuffisance d’infrastructures de drainage rend les populations vulnérables face aux torrents incontrôlables qui accompagnent chaque saison des pluies. Le désastre ne vient pas seulement du ciel : il naît aussi de nos comportements, de notre rapport défaillant à l’espace, à la nature et au bien commun.
L’État, évidemment, porte sa part de responsabilité. Les plans se sont multipliés, mais sans véritable cohérence. Chaque gouvernement a promis la rupture ; chaque ministre a annoncé des solutions “définitives” ; chaque maire a brandi ses projets d’assainissement. Mais sur le terrain, les infrastructures restent inachevées, les ouvrages mal entretenus, les fonds dilués dans une gestion d’urgence permanente. Aux Parcelles Assainies comme à Touba, les infrastructures existantes peinent encore à remplir efficacement leur rôle, en raison d’une gestion parfois insuffisamment coordonnée. L’action publique, éclatée et souvent opportuniste, privilégie la réponse immédiate à la stratégie de long terme. Sans plan global, sans traçabilité des budgets, sans évaluation rigoureuse, les milliards engloutis continueront de nourrir l’illusion d’une maîtrise que nous n’avons jamais eue.
Le problème s’aggrave avec l’urbanisation anarchique qui dévore nos villes. Chaque année, des hectares de zones naturelles d’écoulement sont illégalement occupés. Des quartiers entiers sont bâtis dans des cuvettes inondables, sans systèmes d’assainissement, sans planification, sans respect de la cartographie des risques. Les zones tampons disparaissent sous la pression foncière. À Touba, l’explosion démographique s’accompagne d’une urbanisation sauvage où la construction sur les zones vulnérables se fait sans étude préalable ni plan de drainage. Dans ce contexte, chaque décision prise sans vision alimente la prochaine catastrophe. La pluie ne fait que révéler les failles d’une gouvernance urbaine minée par les intérêts fonciers, la complaisance politique et l’absence de discipline collective.
Cette défaillance n’est pas seulement institutionnelle, elle est aussi culturelle. Nous vivons dans un pays où l’idée même de bien commun se délite sous la pression des comportements individuels. Nous exigeons des infrastructures, mais les dégradons. Nous réclamons des bassins de rétention, puis les remblaions pour bâtir des maisons. Nous dénonçons les inondations, mais jetons nos ordures dans les caniveaux. Nous accusons les autorités, mais participons aux pratiques qui aggravent la crise. Ce paradoxe structurel se lit partout : de Pikine à Touba, des Parcelles Assainies à Fanaye. Cette contradiction entre nos revendications et nos actes nourrit un cercle vicieux où aucune réforme ne prospère. La modernité ne se décrète pas : elle se construit, patiemment, dans les comportements quotidiens et la conscience collective. Chaque sachet plastique jeté dans un canal, chaque construction illégale tolérée est une catastrophe en préparation.
D’autres pays, confrontés aux mêmes défis, ont trouvé des solutions durables. Kigali a choisi une urbanisation strictement encadrée, avec des bassins surveillés, une gestion intégrée des eaux et une discipline collective inculquée dès l’école. Abidjan, après des épisodes dramatiques, a lancé un plan global de drainage combinant ingénierie, cartographie des risques et sensibilisation massive des populations. Ces réussites montrent que la question n’est ni l’argent, ni la pluie, mais la cohérence des choix, la rigueur dans l’application des règles et la volonté collective d’assumer la discipline nécessaire. Le Sénégal n’est pas démuni. Nous avons les talents, les compétences, les ressources. Ce qui manque, c’est une vision ferme, une gouvernance intégrée et un engagement réel des citoyens.
Ce combat ne peut pas être gagné par l’État seul. Lutter contre les inondations ne se résume pas à pomper l’eau quand la catastrophe frappe, ni à annoncer des plans décennaux sans suivi, ni à multiplier des ouvrages qui se dégradent aussitôt. Il faut rompre avec la logique de l’urgence perpétuelle. La bataille est culturelle : il s’agit de repenser notre rapport au territoire, d’imposer une discipline collective, de restaurer la primauté du bien commun et de refuser l’impunité face aux pratiques qui détruisent nos villes. Sans pédagogie sociale, sans transparence dans la gestion des fonds et sans coordination entre l’État, les collectivités et les populations, les milliards continueront de se dissoudre dans la boue et nous resterons prisonniers d’un éternel recommencement.
Les inondations ne sont pas une fatalité. Elles sont un révélateur. Elles exposent notre incapacité collective à planifier, à anticiper, à agir ensemble pour préserver ce qui nous appartient tous. Tant que l’“homo senegalesis” se pensera spectateur et non acteur, tant que la gestion urbaine sera guidée par le court terme et les arrangements politiques, tant que nous n’assumerons pas collectivement la responsabilité de nos choix, les milliards continueront de se perdre et les drames de se répéter. La pluie est un défi, mais c’est notre rapport à nous-mêmes qui décidera si ce pays saura se réinventer ou se résigner.
Hady TRAORE
Expert-conseil
Gestion stratégique et Politique Publique
Fondateur du Think Tank ‘Ruptures et Perspectives’
hadytraore@hotmail.com










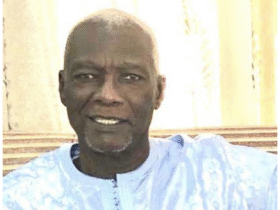




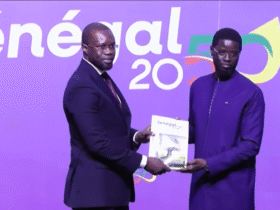

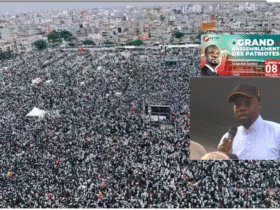
Laisser une Réponse