La critique est une liberté, mais elle devient une légèreté coupable lorsqu’elle méconnaît les enjeux, déforme les intentions et banalise l’effort. En s’attaquant au Plan de Redressement Économique et Social (PRES), Maître Youm révèle moins les failles du texte qu’il ne trahit les limites de son propre cadre d’analyse. Or ce plan, adopté dans un contexte d’urgence budgétaire et de défiance institutionnelle, constitue un tournant stratégique de l’action publique au Sénégal. Ce texte remet les pendules à l’heure, clarifie les choix opérés, et replace le débat à son juste niveau : celui de la rigueur, de la justice et de la responsabilité publique. Car à l’heure où le Sénégal tente de se redresser, le pays mérite mieux que les postures désinvoltes et les saillies mal informées.
Il est des critiques qui tombent à plat parce qu’elles visent haut sans jamais décoller. Et il est des adversaires du progrès qui, faute de maîtriser la matière, s’improvisent procureurs d’une réforme qu’ils ne comprennent pas. Ainsi en fut-il de la sortie de Maître Omar Youm contre le Plan de Redressement Économique et Social (PRES) présenté par le Premier ministre Ousmane Sonko, avec l’appui constant du Président Bassirou Diomaye Faye, dans une rare unité de cap et d’audace. Derrière les envolées stériles, comme celle où Maître Youm parle de « plan de la misère et de la pression fiscale », on cherche en vain la moindre rigueur analytique, la moindre démonstration étayée, la moindre proposition alternative. Ce n’est pas un débat, c’est une esquive maquillée en indignation. Face à ce vide argumentatif, nous avons le devoir non de riposter, mais d’éclairer, d’enseigner, de recentrer.
Car l’ignorance en matière de politique publique ne devrait pas être un instrument d’attaque, mais un appel à s’instruire. Maître Youm aurait gagné à se documenter avant de se prononcer. Il aurait compris que dans l’histoire contemporaine, les plans de redressement ne sont jamais des documents de confort. Ils sont conçus pour agir dans l’urgence, rompre avec des trajectoires délétères, rétablir les équilibres structurels. Ils sont, par essence, impopulaires dans la forme, mais indispensables dans le fond.
Prenons l’exemple du Recovery Act américain sous Barack Obama en 2009 : un choc budgétaire assumé, avec des mesures ciblées, un calendrier de mise en œuvre resserré, et une reddition systématique des comptes devant le Congrès. Ou encore le plan grec supervisé par la Troïka : austère, contesté, mais structuré autour de priorités vitales pour restaurer la solvabilité de l’État. Ces plans n’ont jamais promis le bonheur instantané. Ils ont promis la cohérence et le retour à la confiance. Exactement ce que le PRES entreprend aujourd’hui pour le Sénégal.
Mais, à la différence notable de ces modèles étrangers, le plan sénégalais ne repose pas sur l’austérité dirigée contre les plus vulnérables. Il les protège. Le prix que les couches populaires devaient supporter dans d’autres contextes ne leur sera pas imposé ici. Ce prix sera assumé autrement : par la mobilisation de recettes nouvelles issues de niches fiscales longtemps sanctuarisées, par une fiscalité indirecte plus équitable, par l’arrêt des dépenses superflues, par une remise en question des avantages indus. Là où certains gouvernements ont fait de l’ajustement budgétaire un outil de souffrance collective, celui-ci en fait un levier d’équité.
Sur le plan technique, le PRES s’appuie sur un diagnostic lucide : le Sénégal est à la croisée des crises. Il cumule un déficit de 12,3 % du PIB, une dette proche de 100 %, une perte de confiance dans l’action publique, une crise de la redevabilité et une fragmentation des instruments de pilotage. Le plan propose donc une reprogrammation budgétaire rigoureuse, une priorisation stratégique des dépenses, une refonte des outils de coordination ministérielle, et une mise en cohérence des programmes à travers une contractualisation des résultats.
Cette contractualisation ministérielle inédite impose à chaque membre du gouvernement des objectifs clairs, datés, traçables, avec des évaluations à intervalles réguliers et des sanctions en cas de défaillance. C’est une rupture majeure avec l’ancien système, où la gestion politique tenait lieu de gouvernance. Pour la première fois, le temps administratif rejoint le temps citoyen, et l’obligation de livrer remplace le réflexe de promettre.
Derrière chaque mesure du PRES, il y a une philosophie : l’État au service du réel, et non de la rente. Là où l’orthodoxie financière aurait recommandé des coupes dans les subventions, des hausses généralisées d’impôts ou une réduction brutale des services sociaux, le plan du gouvernement opte pour une voie plus fine, plus juste, plus soutenable. Les populations rurales, les jeunes, les travailleurs précaires, les ménages à revenu modeste ne sont pas la variable d’ajustement du redressement. Ils en sont la cible protégée et la raison d’être.
Ce que Maître Youm ignore ou feint d’ignorer, c’est que l’efficacité ne s’improvise pas. Elle se structure, se budgétise, se mesure. Il ne dit pas que dans toute stratégie de redressement, les premières décisions sont structurelles, transversales, et nécessitent des ajustements profonds avant de produire des effets visibles. Il ne dit pas que ce plan engage une transformation de l’architecture même de l’action publique, de la gouvernance économique, et de la relation entre l’État et les citoyens.
C’est cette méconnaissance manifeste des logiques de réforme qui appelle non pas une riposte, mais une élévation du débat. Plus qu’une réponse partisane, ce texte se veut une leçon méthodologique et politique. Car le peuple sénégalais a trop souffert d’une gouvernance d’improvisation pour accepter qu’un plan ambitieux soit tourné en dérision par des esprits qui n’en saisissent ni la portée ni la complexité. Nous invitons Maître Youm, s’il en a le courage, à relire le PRES avec les outils adéquats : cadre logique, indicateurs SMART, cohérence intersectorielle, benchmark de politiques comparées. Sinon, qu’il s’abstienne de polluer le débat public avec ses approximations.
Mais il y a des propos qu’on ne peut laisser passer sans rétablir le sérieux. Affirmer que ce plan mènerait à la banqueroute, qu’il serait un plan de la misère, de la pression fiscale et de la régression économique, c’est là une charge qui ne se réfute pas seulement par le droit de réponse. Elle se réfute par les faits.
La banqueroute ne se construit pas sur un effort de réorganisation budgétaire. Elle se construit sur l’accumulation de déficits sans contrôle, sur la reconduction de dépenses improductives, sur l’opacité des engagements contractés par l’État. Elle est le fruit de l’irresponsabilité, pas de la rigueur. Et si le pays frôle aujourd’hui certains seuils critiques, c’est précisément à cause de ce qui fut fait avant que ce plan ne vienne remettre de l’ordre. Le PRES ne crée pas le danger : il tente d’en contenir les effets.
Quant à parler de plan de la misère, l’expression est forte, sans doute trop, au point de trahir ce qu’elle tente de masquer : une incompréhension du contenu. Car enfin, quel plan de misère élargit les subventions ciblées pour les produits essentiels ? Quel plan de misère renforce les investissements en santé communautaire, en équipements scolaires, en production agricole vivrière ? Quel plan de misère contractualise des engagements ministériels sur la base d’indicateurs de développement humain ? Ce plan ne produit pas la misère. Il tente de limiter celle qu’on a laissée s’installer.
La pression fiscale, enfin, mérite d’être replacée dans sa vérité. Ce que le plan opère, ce n’est pas un alourdissement brutal et aveugle de la fiscalité. C’est une opération de justice. Il ne s’agit pas de frapper les couches moyennes et précaires, mais de mettre à contribution les niches trop longtemps épargnées, d’optimiser les recettes existantes, de traquer les exonérations abusives. Parler de matraquage fiscal sans faire la différence entre fiscalité directe injuste et fiscalité indirecte redistributive, c’est confondre l’impôt et l’injustice – et donc brouiller le débat.
Et que dire de cette idée selon laquelle le plan serait trop peu créatif, pas ambitieux, et infaisable ? Là encore, tout dépend du sens que l’on donne aux mots. Si la créativité consiste à inventer de nouveaux slogans sans ancrage dans le réel, alors ce plan n’est effectivement pas créatif. Mais s’il s’agit de concevoir une méthode rigoureuse, une séquence d’exécution claire, et une logique d’impact public mesurable, alors ce plan est l’un des plus audacieux que le pays ait connus depuis des décennies. Car l’ambition, aujourd’hui, c’est de produire, pas de plaire. C’est de délivrer, pas de briller.
La critique est légitime. Elle est même nécessaire. Mais elle engage, elle aussi, une responsabilité : celle de rester à la hauteur du débat. On ne décrète pas l’échec d’un plan avant sa mise en œuvre. On n’assène pas des formules définitives là où le pays réclame du sérieux. Les Sénégalais n’ont plus besoin de commentateurs en colère. Ils ont besoin de décideurs lucides.
Le PRES n’a pas vocation à séduire. Il a pour mission de stabiliser, reconstruire et rendre justice. Dans cette époque où l’apparence a longtemps primé sur la performance, c’est une révolution silencieuse, mais déterminante. Une révolution qui mérite mieux que les sarcasmes d’un ancien ministre en manque de boussole. Et une réforme qui impose, à ceux qui critiquent, de réapprendre à penser avant de parler.
Hady TRAORE
Expert-conseil
Gestion stratégique et Politique Publique-Canada
Fondateur du Think Tank : Ruptures et Perspectives
hadytraore@hotmail.com










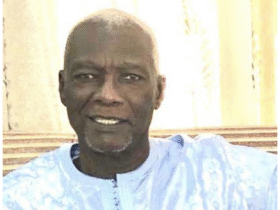



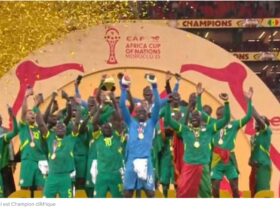
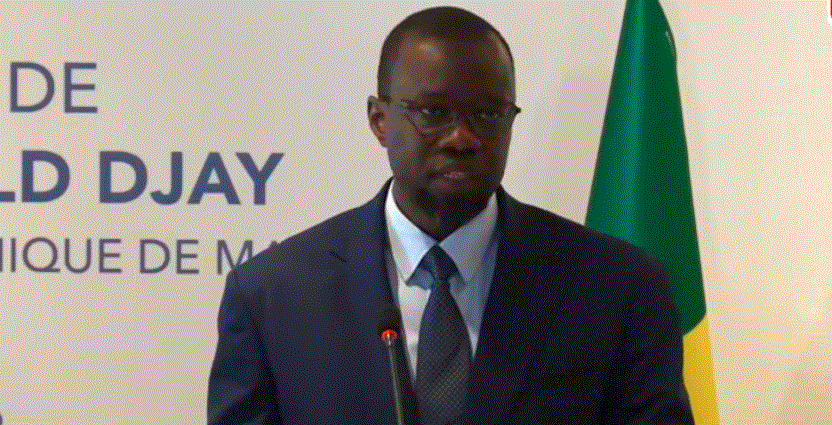


Laisser une Réponse